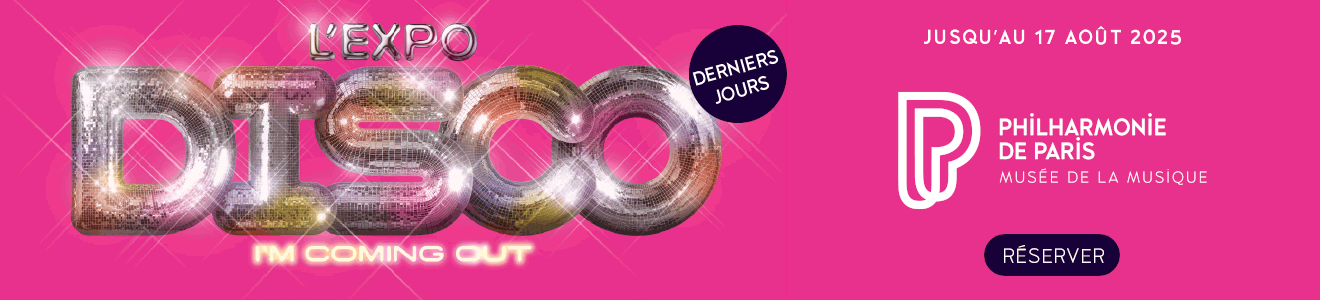Trois ans après le sombre Piano Ombre, Frànçois & The Atlas Mountains troque une partie de sa poésie romantique pour une forme de réalisme politisé qui fait du bien au paysage pop français. Un disque engagé qui marquera l’année.
En 2014 sur Piano Ombre, François Marry s’était guéri de tout un tas de dures péripéties personnelles, un disque à la part sombre évidente, mais pourtant plein d’espoir, où l’humanisme et la poésie délicate de son créateur nissaient par triompher. Trois ans plus tard, on retrouve François dans les bureaux du Trabendo à Paris, où il répète pour la performance exceptionnelle de Rone qui doit se tenir quelques jours plus tard dans le cadre prestigieux de la Philharmonie. Aujourd’hui, c’est un album bien différent que nous propose le natif de Saintes, un album qui, sans se départir de l’élégance poétique de l’écriture de François, semble s’être pris une grosse claque réaliste quant à l’état du monde. Celui qui vit désormais en Belgique a mis les pieds sur terre et l’atterrissage est douloureux.
Tu es du genre grand voyageur, mais aujourd’hui tu as posé tes valises en Belgique. Est-ce définitif ?
Non je vois vraiment Bruxelles où j’habite actuellement comme un lieu de passage, une étape. J’y ai ren- contré beaucoup de gens bienveillants, de créateurs qui ont des lieux pour s’amuser, des moyens d’agir: tout y semble instinctif, les gens se posent moins de questions. C’est valable pour la danse, le théâtre, la musique, la peinture, etc. Il y a beaucoup de petits lieux, des genres de squats, mais assez organisés. Bruxelles est la capitale de l’Europe, alors il s’y passe beaucoup de choses au niveau décisionnel et poli- tique. Et malgré ça c’est une ville assez petite, où tu peux tout faire à pied, pas bien chère, moi qui aime aller en concert, je peux le faire tous les soirs sans me ruiner pour autant. C’est fonctionnel pour un artiste.
Mais c’est aussi un choc que d’habiter dans une grande ville ?
Bien sûr, le bruit des voisins qui bougent des meubles au-dessus de chez toi, la grisaille, la pollution et à Bruxelles, le chaos visuel. C’est une ville divisée entre plein de communautés qui s’entendent bien, mais font tout à leur manière, alors il n’y a aucune cohérence, difficile d’y trouver une beauté fixe. Du coup, j’ai cherché d’autres angles pour apprécier la ville visuellement. Comme François Schuiten par exemple, un dessinateur de BD qui révèle l’architecture néoclassique (auteur en particulier de la mythique série des Cités obscures, ndr), je lisais la ville à travers sa grille de lecture en trouvant de beaux endroits, comme le Palais de Justice où on a tourné la vidéo de “Grand Dérèglement”. Et aussi la peinture symboliste du fin XIXe, qui représente les intérieurs bourgeois de manière assez onirique, il reste pas mal de ces vieux appartements, le parquet, les cheminées, les colonnades, etc. La vie nocturne foisonnante est intéressante aussi, l’obscurité rend la ville plus scintillante et compréhensible. J’ai un peu lâché l’aquarelle, qui convenait mieux à la nature, je me suis remis à dessiner et un peu aux pastels en suivant les symbolistes belges.
Il y a trois ans, tu nous confiais ta peur de perdre tes musiciens, qu’ils soient trop occupés pour travailler avec toi. Aujourd’hui, c’est arrivé.
J’ai heureusement la sensation qu’on avait accompli tout ce qu’on avait à faire ensemble sur Piano Ombre. Se séparer de Pierre (Loustaunau, alias Petit Fantôme, ndr) et Gerard (Black, alias Babe, ndr) a été entièrement naturel. On avait atteint les limites du feu qu’on avait ensemble, chacun avait envie de transporter sa torche dans son coin. C’était presque un soulagement en fait, quand je leur ai envoyé un message pour leur dire de se consacrer à fond sur leur propre projet, je me suis dit que je repartais sur des bases fraîches. Ça me permet d’écarter plein de pistes musicales qui parfois me contraignaient : ils avaient une manière de jouer bien propre à eux, qui est autant un point fort qu’une limite. David du groupe Colisée avait fait nos premières parties. C’est un genre de génie musical, il a rejoint le groupe. Pour le disque il y a aussi les cordes d’Owen Pallett, dont je suis vraiment fan. C’est une proposition de Domino, je n’allais pas refuser! Sa sensibilité, sa capacité à en mettre plein la vue tout en étant hyperdélicat… On a tout fait par mail, il habite aux USA, je ne voulais pas plomber le budget de l’album.
Ta famille musicale s’est élargie au-delà des montagnes, avec Rone ou Étienne Daho. Qu’est ce qu’ils t’apportent ?
C’est un régal de se rendre compte que l’homme derrière la création est tout aussi profond et authentique. Daho était venu nous voir à un concert, on a discuté, on a un peu flashé, on s’entendait trop bien alors qu’on connaissait mal le travail de l’autre. C’est devenu un grand frère, je le vois peu, mais quand je le vois c’est pour de vrai, je lui parle de tout, il me conseille énormément… Il comprend ma passion pour les musiques indépendantes, il voit les complications d’un milieu musical basé sur l’image, la légèreté, l’obligation de se vendre, etc. Il m’explique comment ménager la chèvre et le chou.
Tu as toujours le sentiment qu’évoluer dans la musique c’est une affaire de compromis?
Bien sûr, tu marches sur un fil. Tu es dans les airs, donc ça reste agréable. Mais si tu cesses de jouer le jeu, tu ne fais plus des albums et tournées comme tu l’entends.

Venons-en au disque. Quand a-t-il germé ?
Je suis lent, je laisse pousser les choses, j’arrose. J’ai collecté des phrases, des riffs depuis des années. J’avais répété “1982” dans une forêt à Oléron il y a six ans. Quant à “Bête morcelée”, c’est un texte que j’avais dans mes journaux intimes, que j’ai collé sur un riff grunge sur lequel on se marrait avec les copains. J’écris beaucoup dans les parcs, le seul endroit vert des villes et où je peux chanter sans gêner personne. Ma salle de bain est bien aussi, lumineuse.
Tu voyais le précédent album comme une guérison, liée à des problèmes personnels. Et celui-ci ?
Je le vois comme un oxymore, il est très sincère et intime et pourtant il est moins émotif.
Tu t’es pris un mur de réalisme.
Voilà, et cette claque réaliste me donne l’impression que ce disque est un peu en dehors du cocon de mes émotions, comme s’il était plus brut, ce qui correspond moins à mon tempérament, ça me surprend. Et pourtant il n’est pas moins personnel…
Il y a trois ans tu nous expliquais que ta bienveillance te permettait de ne pas en vouloir aux hommes de ce monde qui tourne de moins en moins rond. Aujourd’hui tu sembles de plus en plus en colère contre le système.
Tu as raison. Je reste convaincu que l’on peut comprendre ce qui pousse chaque humain à agir individuellement. Mais c’est la manière dont ils interagissent, comme ils font monter la sauce, qui dégénère. Ces conflits sont manipulés par des groupes mal intentionnés, dans des proportions catastrophiques et alarmantes. Ma colère est dirigée contre ces manipulations, pas contre les hommes.
Il va falloir assumer que c’est un album politique. Cela te fait peur ?
Un peu, mais avec tout ce que le pays s’est pris ces dernières années, il ne faut plus avoir peur du mot “politique”… comme il ne fallait pas avoir peur d’être un groupe qui chantait en français. (rires) Je me suis rendu compte que beaucoup de musiques que j’adorais étaient politiques : les groupes africains, le reggae, enfin le reggae original, je ne parle pas de Pierpoljak, le dub, etc. Ces musiques-là étaient sensuelles et groovy, mais politiques. Quand je suis allé en Afrique, je demandais pourquoi on ne voyait plus jouer l’Orchestre PolyRythmo de Cotonou par exemple, les Béninois m’ont expliqué que ces artistes dans les années 70 étaient payés pour jouer à des meetings politiques. Quand les mouvements politiques n’ont plus eu de moyens financiers, ça n’a plus marché.
Ces groupes politisés émergent souvent quand il se passe quelque chose de terrible dans leurs pays. Peut-être qu’en Occident, on est entré dans ce genre de situation.
On n’est plus sous les Trente Glorieuses, alors on est moyen yéyés… Les artistes comme les journalistes sont des éponges, on relaie ce qui gravite autour de nous en les passant par notre filtre.
Ça commence fort avec l’ouverture, “Grand dérèglement”, qui sonne comme un manifeste de décroissance. C’est une idée que tu affectionnes ?
C’est une idée qui m’intéresse, c’est une des réponses à ce qui se passe, c’est sûrement celle qui correspond le plus à ma personnalité. Mais je ne veux pas me lancer dans des explications parce que je ne suis pas celui qui les articulera le mieux, je préfère que les gens aillent lire ce que dit Pierre Rabhi (essayiste et agriculteur, engagé dans le développement de pratiques agricoles prenant en compte l’environnement et qui préservent les ressources naturelles, chantre de la décroissance, ndr).
Sur “Apocalypse à Ipsos”, tu parles même de rire de la mort de ceux qui crachent de la haine, ça surprend.
C’est une pirouette, qui joue sur le côté guilleret du morceau, je trou- vais ça rigolo d’y glisser “allez tous crever”… enfin pas “tous”, ceux qui sèment la zizanie. Mais je n’ai pas de haine en moi, c’était pour utiliser leur langage, le retourner contre eux.
Tu as toujours semblé ne pas tout à fait avoir les pieds sur terre. Est-ce que tu aimerais plus te confronter à la réalité, t’engager ?
J’aimerais être plus militant, je serais plus fier de moi si je pouvais te parler d’une action sociale, plutôt que d’un album que j’ai enregistré. Je ne suis pas vraiment fier de mon activité d’artiste. Et de la lâcheté que j’ai à ne pas libérer de temps pour des causes humanitaires, par exemple. D’un point de vue plus métaphorique, sensible, je fais un effort pour essayer de me raccrocher à cette terre, c’est pour ça que cet album a une facture plus réaliste, qu’il fait écho à des situations politiques et sociales. Tout seul chez moi, je passe mon temps à faire de la musique abstraite, des drones, de l’écriture automatique, des peintures psychédéliques. C’est intense et personnel pour moi, ce sera toujours là. Mais je dois être vigilant et faire un effort pour me relier à l’autre, la vie sur terre est courte il faut en profiter maintenant.
Sur la même chanson tu parles beaucoup de famille. En fonder une, c’est une envie qui te hante ?
Ça me hante oui… On peut le dire, c’est le bon mot, dans toutes les formes qu’il peut prendre. C’est aussi un hommage terrien d’un individu à ses proches par le sang, c’est pour leur faire coucou.
Tout cela donne un relief assez dur au disque, comme un passage à l’âge adulte tardif, des illusions qui se brisent.
Oui, il y a une forme de responsabilisation. Mais on dirait que ça a pris plus la forme d’un passage à l’âge adulte sur cet album que dans ma vie personnelle ! (rires)
Ton album sort en pleine période électorale. Tu suis l’actualité politique ?
J’essaye de chercher des étincelles chez ceux qui parlent, mais je n’en trouve pas beaucoup.
Tu as enregistré le disque à Molenbeek, pourquoi ?
Il y a juste un super studio pas cher ! Le quartier était calme et sans distractions, toute la nervosité est facilement désamorçable. Il y a un titre qui sera en bonus sur l’édition limitée, “Night Thoughts, Day Dreams”, sur lequel on entend des enfants qui parlent. Je dessinais sur la place à côté du studio, un attroupement d’enfants s’est fait autour de moi, plein de militaires passaient, mais eux commentaient mes dessins, parlaient de la fête des mères… Un moment très joyeux.
Tu as l’habitude d’enregistrer dans l’urgence, qu’en fut-il ce coup-ci ?
On a eu un rab de quatre jours par rapport au précédent, douze jours d’enregistrement ! Et seulement quatre jours de mix, ce qui est déraisonnable. Cet album a été une projection mentale pendant une année et quand on s’est retrouvé dans le réel, il a fallu saisir le moment, cristalliser, ne pas tergiverser. Si j’avais été tout seul, j’aurais paniqué. Mais là, la surexcitation a créé une chaleur très intense avec le groupe. Faire con ance à l’urgence, c’était incroyable. Le produc- teur avait son mot à dire aussi, quand on jouait les morceaux à la Pavement, il faisait une moue qui voulait dire “unimpressed”. Il a fait le tri.
Malgré tout ce qu’on vient de dire, musicalement c’est un disque très apaisé, presque familial.
Tant mieux! Je pense que c’est parce qu’il n’y a pas de maniérisme, on n’avait pas de volonté artistique acharnée, du genre: “On va faire un album électro qui tue.”
Pourtant, il y a la violente “Bête morcelée”, qui sonne comme un petit caprice.
Comme un oncle ivre au Noël en famille ? (rires) Ce n’est pas un caprice, il y avait beaucoup de morceaux comme celui-là, c’est le seul qui a survécu à l’écrémage, peut-être parce qu’il était aussi intensément capricieux et court. Les autres membres du groupe ne voulaient pas le mettre, mais ils m’avaient fait virer assez de morceaux rock comme ça, celui-là, je le garde, vous êtes gentil. (rires) Il était nécessaire aussi par rapport au fond… Et j’y vois un exutoire de tout un tas de choses qui me traversent et que je ne peux pas exprimer sous la forme de poésie afro-groove… Il multiplie aussi les clins d’œil à Petit Fantôme, qui n’est pas sur l’album. Il fait partie de ma personnalité, il fait un tunnel vers mon moi de quatorze ans.
Est-ce qu’il y a un album de rock énervé de François qui pourrait surgir un jour ?
Il y en avait un dans l’œuf. J’ai été à Los Angeles en décembre dernier pour voir Burger Records, j’avais quelques contacts par Hedi Slimane. Je fantasmais sur The Garden, Thee Oh Sees, je voulais voir de plus près, j’ai parlé au boss de Burger, etc. J’ai trouvé ça super, effervescent, mais je suis arrivé un peu tard, j’ai le sentiment que c’est en train de devenir une formule… et comme tout ce qui vient des USA, l’image qu’on s’en fait n’a pas le même éclat sur place. L’album grunge, j’aimerais bien le sortir, mais on verra… dans le Sud-Ouest, ils ont l’air bien branché garage, on doit pouvoir faire un truc rigolo entre deux sessions de surf.

C’était quoi ce fameux projet avec Hedi Slimane ?
Il a fait une campagne pour Yves Saint-Laurent autour de la nouvelle scène française, avec La Femme, Moodoïd, Grand Blanc, etc. On s’est retrouvé en colonie de vacances de 48 heures dans un hôtel luxueux californien. Slimane organisait des soirées après les défilés, dans un sous-sol de club minuscule, où se côtoyaient Daft Punk, Jack White ou Paradis, la scène underground garage de Los Angeles, tous les mannequins du défilé et beaucoup d’alcool. Et au milieu de tout ça des instruments, dont chacun se saisissait quand il le voulait, lâchage complet, je me suis retrouvé à jouer des reprises de garage des années 70 avec les gars de Franz Ferdinand. Mais il y avait aussi des mannequins bourrées qui débitaient des phrases en espagnol. Au milieu de tout ça, Hedi Slimane regardait la jeunesse dévergondée, qui nourrissait ses collections et son journal intime. Ce lâchage d‘énergie m’a rappelé mon adolescence. On a tourné ensuite en Australie avec La Femme, c’était drôle de voir qu’on était une génération à avoir envie de tant d’énergie. J’en ai aussi trouvé des échos quand on a joué au Caire. Les morceaux qui marchaient les mieux étaient les plus rock, bruts, saturés. Alors qu’on pensait que c’était nos emprunts aux musiques africaines qui fonctionneraient le mieux. C’est comme un rendez-vous amoureux où tu cherches à te préparer, jusqu’aux répliques que tu vas sortir. Mais tout ce que tu prévois dévie et ça fait partie de la magie.
À quatorze ans, tu écoutais qui ?
J’aurais honte de le dire !
Il ne faut pas, j’avais un poster de Sinclair dans ma chambre.
(rires) Alors c’est bon, je peux tout dire, c’est donnant donnant. C’était avant Internet et je vivais à Saintes, une petite ville. J’ai découvert Deftones en faisant du skate, j’ai renversé le carton d’un disquaire qui avait jeté le CD à la poubelle. J’avais quatorze ans en 1994, Nirvana à fond, et pour le reste je regardais les magazines de musique. Guitar Parts que j’achetais parce qu’il y avait des médiators gratuits dedans et Rock Sound avec des CDs. Silverchair, Mass Hysteria, Soul y, Pantera, Korn, le surf, le skate, etc. J’aimais beaucoup les Français de Spicy Box aussi, un morceau s’appelait “Plein pouvoir à ton corps” et un autre “C’est le consensus, tout le monde suce”. J’avais un poster de Korn où le mec avait marqué sexe sur sa main, je l’avais mis sur la porte de ma chambre pour faire chier ma mère.
Tu parlais de tes tournées en Afrique ou au Moyen-Orient, tu as aussi écrit pour un spectacle de danse. Ces projets “alternatifs” te sont importants ?
Bien sûr, parce que le circuit classique album/tournée est très limité. J’ai une chance de dingue, mais je suis très curieux culturellement, je rêverais que tout le monde soit comme moi, qu’au lieu d’aller voir deux concerts dans l’année, PNL et Johnny, les gens aillent en voir cinquante petits. Je rêverais que tout le monde ait cette démangeaison d’aller voir tous les soirs le type du coin qui fait un truc bizarre. J’essaye de nourrir cette partie de moi. Je rêve d’une manière de sortir de la musique où il n’y a pas besoin d’image de groupe fixe. J’ai envie d’une formule inclusive, jammer, interchanger. Mais c’est moins vendeur, les gens qui consomment de la musique n’ont pas le temps de rentrer dans les délires des artistes, il leur faut un packaging. Et je ne leur jette pas la pierre, c’est probablement comme ça que je suis avec le cinéma.