Cela ne sert à rien de s’éterniser sur l’année passée, spéciale, pour dire le moins. Est-ce la crise pour les musiciens ? Certainement. Est-ce la crise pour la musique ? Pas encore. Vous avez d’ailleurs pu vous en apercevoir avec NOUVEAUX FUTURS, notre playlist hebdomadaire qui, chaque semaine depuis janvier, a mis en avant tout ce qui est sorti de meilleur et a un goût de demain. C’aura été l’occasion pour certains artistes de confirmer, pour d’autres d’émerger.
En cette fin d’année, le curateur de la playlist Jon Beige en a choisi dix pour qui l’année 2020 aura été un tournant et dont le succès pourrait (devrait ?) l’année prochaine frapper à leur porte. Mais il ne s’agit pas là d’un pari ou d’une apostrophe envers le lecteur pour lui dire « crois-nous sur parole, ça va percer », mais plutôt d’un encouragement et la constatation que ceux-là, cette année qui se termine, auront apporté quelque chose de neuf et de singulier au monde de la musique et que, dans un monde idéal, oui, ils devraient tout casser en 2021. Dans un monde idéal.
Sélection, textes et interviews par le curateur de la playlist NOUVEAUX FUTURS, Jon Beige
AceMoMA (USA)

Difficile de les suivre en ne s’y intéressant que de loin. AceMoMA, c’est la fusion de AceMo (à droite sur la photo) et MoMA Ready. C’est surtout la fréquence des sorties qui donne le tournis. Et bien que la manie de sortir cinq albums par an, comme le font beaucoup de groupes de rock par exemple, ne paye pas souvent, ça fonctionne quand la recette est simple et efficace. Les deux new-yorkais n’ont pas inventé le fil à couper le beurre, mais ils savent très bien s’en servir. Que ce soit à deux où en solo, que ce soit jungle, footwork, house, techno, il y a toujours un je-ne-sais-quoi de style, un surplus de coolitude, un supplément d’idée, un petit twist en plus, qui fait honneur aux parrains des années 90 qu’ils saluent évidemment. Presque comme un podcast, c’est un plaisir de consulter chaque semaine ses mails Bandcamp pour y découvrir quasi-systématiquement un nouvel EP sur leur label Haus of Altr, une collaboration, un travail de production (on attend impatiemment l’album de ize produit par AceMo), un album, une énième compilation, surtout si on y ajoute leurs compères DJ Swisha et Kush Jones, qui ne chôment pas non plus. Et malgré tout ça, c’est peut-être en tant que DJs qu’ils fascinent le plus. Qui n’aurait pas envie d’être pote avec eux quand on regarde leurs deux Boiler Room (1 et 2), ou leurs mixes pour The Lot Radio. Un peu comme les gars en place du lycée, qu’on connaît par cœur mais qui ne nous connaissent pas. D’ailleurs, ils n’ont pas répondu à nos mails.
Azu Tiwaline (TUN/FRA)

© Loten Grey
À la fin de Gladiator, après des années de voyage, de tension et de combat, à devoir faire ses preuves, Maximus Decimus revient sur ses terres, caresse les chants de blé, et sent le souffle tiède du vent emplir l’espace, le soleil l’envelopper. Il atteint la quiétude. C’est aussi le parcours d’Azu Tiwaline, à la seule différence qu’elle n’est pas morte, et que l’histoire est loin d’être finie. Après presque vingt ans de parcours sous l’alias Loan, à explorer toutes les facettes de la bass music et tout ce qui commence par « dub- » ou finit par « -step », Donia est allée s’installer près de sa mère, dans le Jérid tunisien. Et puisqu’il n’est pas un seul artiste qui ne soit pas influencé par son environnement, sa musique s’est faite plus douce, spacieuse, chaleureuse, lumineuse. La maturité tombe à pic. Elle le disait en interview, quand on est jeune, on a besoin de s’affirmer, pour se prouver des choses. Mais aujourd’hui, c’est surtout a elle-même et à ses proches qu’elle veut faire du bien. « Je pense qu’il vaut mieux se foutre de pas mal de choses et avoir beaucoup de recul. Continuer à toujours faire ce qu’on a envie. Que ça « marche » ou pas. » Le secret, pour elle, c’est « aimer et s’aimer ». Ses premières sorties sous ce nom se font en 2020. « J’ai sorti mon premier album sous le nom d’Azu Tiwaline, Draw Me A Silence, au mois de mai, chez I.O.T. records, mon label de cœur, ma famille. Cet album a reçu un accueil vraiment chaleureux, particulièrement à l’étranger. Puis j’ai signé chez Livity Sound en juillet. Et là, tout a pris une tournure assez géniale. » En voilà une drôle histoire, de signer chez un des plus gros label de UK bass music lorsque justement on comptait s’en éloigner. Mais de la même façon que ce sont les groupes de métal qui font les meilleurs slows, c’est peut-être après avoir expérimenté en sous-terrain qu’on peut savoir vraiment apprécier la lumière.
Crack Cloud (CAN)

© Jenilee Marigomen
En découvrant Crack Cloud, il n’est pas aisé de tout comprendre, visuellement déjà. Sur la pochette de leur album Pain Olympics, on dénombre quinze belligérants, soudés au milieu d’un monde dystopique presque caricatural. Crack Cloud pourrait tout aussi bien s’appeler 2020 : The Musical. Tout ce beau monde, basé à Vancouver, fait partie du collectif – terme qu’ils utilisent pour se définir – et participe à sa façon au développement du projet. Une communauté, une famille même, dont le but premier était avant tout la guérison, quels qu’en soient les maux, comme l’addiction (The Next Fix). Et la transcendance par l’art total. Autant de notions un peu désuètes qui font souffler du nez. Souvent, ces concepts ne font que meubler une œuvre qui, prise en tant que telle, est ennuyeuse. Mais c’est par l’autre bout qu’on se fait d’abord attraper : la musique. En 29 minutes et 8 morceaux, il se passe autant de choses que pour certains artistes en toute une carrière. On y dénombre pléthore de références marquées, de Devo à Gang of Four, d’ESG à Talking Heads, ou même à Queen, le tout digéré dans l’urgence en une pièce de théâtre auditive. Chaque écoute révèle une grille de lecture réorientée, des sensations inédites. Tantôt rayonnant, tantôt accablant, il est rare d’écouter un album si riche et porteur d’espoir et de désespoir à la fois.
Emma DJ (FRA)

Certains artistes commencent leur carrière sur la pointe des pieds. Pas Emilio. Rien avant 2019 hormis ses soirées Fusions mes Couilles dont il a la paternité, puis trois albums d’un coup, tous sortis sur Lavibe, le label de Brice Coudert. Deux sorties en cassette, format bien opportun pour les sonorités poussiéreuses de ses productions ; la troisième ne prend pas le temps d’une sortie physique. On pourrait trouver tout cela précipité. Pourtant, chaque partie du triptyque raconte une histoire. L’ambiance y est malsaine et dissonante, les percussions ne restent jamais à leur place, tout se lie dans un maelström de distorsions réglées impeccablement. Contrairement à beaucoup de morceaux de cette vague punk-expérimental-de-chambre, la musique d’Emilio se reconnaît tout de suite. À l’écoute de « Burnout Library » et « Slug Just« , deux titres qui ont fait l’objet de vidéos magnifiquement dérageantes, on ne peut douter qu’ils sont issus du même esprit vicelard. En 2020, sa musique a continué à se répandre, hyperactive et toujours bien référencée. Un autre album au format cassette chez les copains de BFDM, deux fantastiques sorties sur Collapsing Market, au sound design encore plus affirmé, presque raffiné, sans que cela nuise à l’ambiance caverneuse et psychotique qui fait sa singularité. Une sortie chez L.I.E.S. aussi, comme une évidence, puis un autre album à peine annoncé sur High Digital. Là, un morceau sur la compilation Mutants d’Arca. Pas de vinyles, pas de streaming, pas d’interview. Pas de fête non plus, Covid oblige, mais quelques mixes bien sentis pour Dekmantel et Boiler Room. Emma DJ donne l’impression d’aller là où le vent le mène, tout en sachant d’avance où il le mènera.
Kate NV (RUS)

© Richard Jonathan Miles
Il était une fois une petite fille russe qui faisait du vélo en chantant. C’est ainsi que pourrait commencer le conte de Kate NV. « Quand j’avais deux ans, je fonçais sur mon tricycle dans l’appartement, et forçais mes parents à me suivre en chantant des chansons pour enfant. Je n’en connaissais que deux, que je chantais sur une unique note. Ma mère s’est dit que, bien que je devrais apprendre à chanter d’autres notes, au moins j’avais le sens du rythme, parce que je me mettais en colère s’ils ne respectaient pas la pause entre le couplet et le refrain. » L’enfance, on s’y replonge forcément en écoutant Room For The Moon, son troisième album déjà, toujours chez l’indispensable label RVNG Intl., avec ses influences évidentes pour la musique japonaise et sa naïveté enchanteresse, d’un point de vue visuel notamment. Une enfant solitaire dont la musique et ses mondes imaginaires seraient ses seuls amis, et à la fois l’expression d’une personnalité définitivement joyeuse. « Ce que je compose est spécial pour moi, au moins parce que le processus de création me rend heureuse, et que ça me fait me sentir dans un cartoon cool. Ce qui est beau avec la musique, c’est qu’elle a un sens différent pour chacun, et qu’en retour, chacun lui donne quelque chose de particulier. » Ses morceaux, tout sauf niais, brillent par leur maturité. Ses précédents albums, bien plus expérimentaux, ont fait place à une assurance grisante, à une identité affirmée, et des compositions magnifiquement construites. Il y a au-delà de la seule pulsion instinctive, qui irrigue souvent en quasi-solitaire la musique de chambre contemporaine, un supplément d’effort. Il en faut, mais savoir construire un album comme un tout, écrire des mélodies, les assainir, se débarrasser du superflu, mettre son ego de côté, se mettre en avant dans toute sa fragilité, rendre sa musique accessible, tout ça n’est pas à la portée de tous, en tout cas pas comme ça.
Lyra Pramuk (USA)

© Martin Sabhi
En tant qu’art majeur, quoi qu’on en dise, questionner la nature même de la musique, ses limites et étiquettes, ne fait pas de mal. Peut-on faire de la musique électronique sans aucun instrument ? La question ne se pose plus désormais, puisque Lyra Pramuk a composé son premier album, Fountains, à l’aide de sa seule voix. Tout ce qu’on y entend, même ce qui ressemble à tout sauf à ça, y trouve sa source. C’est bien naturel au vu de son parcours, qui débute à l’âge de cinq ans dans des chœurs religieux d’une petite ville de Pennsylvanie. Elle y développe un monde intérieur incroyablement riche et secret, jusqu’à son départ pour Berlin qui lui servira d’exutoire, notamment dans les clubs. Ces démultiplications fractales se retrouvent dans ses techniques de productions fascinantes, où le matériau de base est souvent composé d’un simple échantillon, essoré, jusqu’à la division cellulaire, pour recommencer encore. Sa musique donne l’impression que l’histoire de l’humanité est une boucle, et que la fin sera le début, et inversement, tant on ressent des émotions à la fois primaires et inconnues, familières et inqualifiables. « Alan Watts a dit : « Essayer de se définir soi-même, c’est comme essayer de mordre dans ses propres dents. » Je suis seulement qui je suis, je fais ce que je sais faire de mieux. Je suis un animal désordonné. Je compose avec ce qui me vient de la façon la plus rapide et naturelle possible. J’aime fusionner complètement avec la technologie. Si faire l’amour à une machine était possible, ça ressemblerait sûrement à ça. »
Model Home (USA)
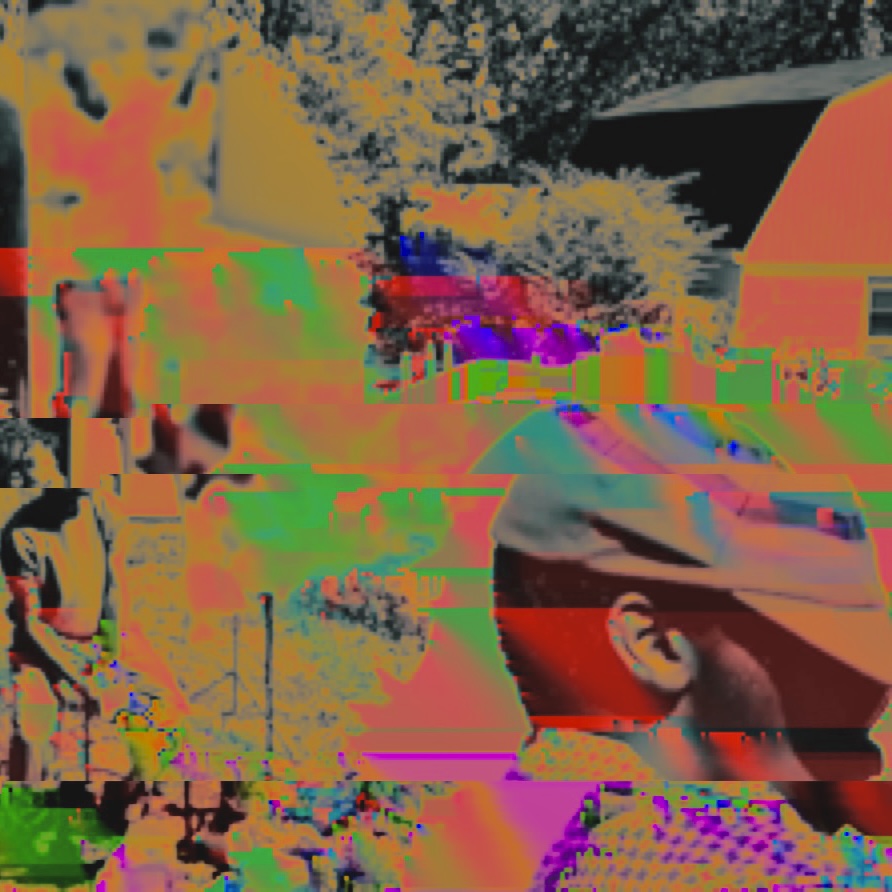
© Max D
« Model Home », maison témoin en français. Selon Wikipédia – oui, il existe une page Wikipédia sur les maisons témoins – il est dit que dans le cas d’une construction en cours de réalisation, elle sera utilisée pour être le modèle à suivre. Difficile de dire si la musique qui se construira à l’avenir prendra Model Home pour exemple, mais elle peut. Situé exactement au milieu d’un triumvirat hip-hop/musique électronique/rock, il n’y a absolument rien qui ressemble au groupe aujourd’hui. « Nous sommes des chercheurs sur un chemin, et nous nous sommes rencontrés sur le trajet », raconte Pat Cain, chargée des prods. Le chemin, c’est en l’occurence Washington D.C., dont sont originaires les deux membres originels du groupe, Pat et le rappeur Nappynappa, et rejoint l’année dernière par Maxmillion Dunbar, alias Dolo Percussion, aussi tête pensante du label Future Times (on est en plein dedans) sur lequel il a sorti cette année leur musique commune. En deux années d’existence, le groupe a sorti plus de vingt projets différents, dont quatre albums rien que cette année. « Ce que je trouve particulier dans notre musique, c’est qu’elle est l’expression d’une immédiateté », confesse Nappynappa. On veut bien le croire. Pat ajoute : « Tout ce que nous créons est l’expression d’une relation entre nous, en tant que personnes, le son qui en ressort, et nos collaborateurs. » Pour eux, le processus créatif se doit d’être total et désintéressé, le tout avec une « sincérité totale ». Il est de toute façon impossible d’écouter leur musique sans imaginer qu’elle soit le fruit de longues séquences d’improvisations. Leur art se veut total, et pour eux, l’avenir se situe dans le dépassement des simples limites de la musique. « Nous voulons mettre en place quelque chose de plus profond, à travers la vidéo, la musique, la nourriture, les vêtements, le vin, des performances conceptuelles plus larges. » Travaux en cours.
Nailah Hunter (USA)

© Angel Aura
Le qualificatif « fonctionnel » était jusqu’à présent réservé à la musique de club, mais pourrait tout aussi bien s’appliquer à l’ambient qui, après s’être développée passivement pendant des décennies, est en train de s’imposer, doucement mais sûrement, comme un style majeur, au même titre que la musique électronique, le hip-hop ou le rock. C’est osé de le dire, oui. Cela implique donc des subdivisions, autant qu’il existe d’émotions. Il n’y a dans le premier EP de Naliah Hunter, Spells, sorti cette année sur Leaving, que quatre ingrédients : sa harpe, des synthétiseurs, sa voix discrète, et du field recording. C’est peut-être ce dont on a besoin en ce moment, retrouver l’humanité des vrais instruments. « J’ai commencé la musique avec des leçons de piano, et en chantant dans des chœurs. À 11 ans, j’étais plutôt auteur-compositeur et guitare, j’écoutais aussi beaucoup de musique de film. Aussi, j’ai toujours été fan de fantasy, de science-fiction. Donc oui, on peut dire que mes débuts étaient plutôt éclectiques. » Parmi tous ces instruments, c’est donc la harpe qu’elle a choisi aujourd’hui, après une longue crise de créativité, qui a laissé place à une créativité de la crise. Sa musique résonne avec les fantasmes, les mondes imaginés et apaisants, la musique à l’intérieur de soi. « Ce projet musical, c’est faire la rencontre de moi-même en utilisant les outils que j’avais sous la main, et explorer ce que j’avais besoin de ressentir. » Le but n’est pas à la démonstration mais à l’écoute introspective. De quoi ai-je besoin. La musique comme guérison. Comme un mantra. C’est de cela qu’on a besoin.
Nubya Garcia (UK)

© Adama Jalloh
Tout comme le vinyle, qui aurait pu croire que le jazz reviendrait se faire une place sur le devant de la scène ? Depuis presque dix ans maintenant, les virtuoses affluent tous azimuts, bien souvent de Londres comme Nubya Garcia, native de Camden, saxophoniste pas trentenaire et déjà bien enracinée. Bien connue des amateurs de jazz, avec une poignée d’EPs à son actif, plusieurs collaborations et récompenses spécialisées, c’est plus largement auprès des amateurs de musique tout court qu’elle s’est imposée cette année grâce à son premier album Source, produit par Kwes (Bobby Womack, Solange, …), aux sonorités hétéroclites et, comme tous ses jeunes confrères, résolument modernes. Pourtant, son initiation musicale se fait très classiquement. « J’ai commencé par le violon lorsque j’étais jeune, puis j’y ai ajouté le piano, avant que le saxophone ne s’impose. J’ai commencé par écouter de la musique classique, et ce n’est que plus tard que j’ai été exposée à d’autres genre et influences. » Mais quand un artiste qui mélange traditions et modernité maîtrise son instrument avec tant de virtuosité, il est difficile d’envisager qu’il ait pu faire le chemin inverse. Irréprochable techniquement, cela lui permet de se focaliser sur la dimension spirituelle de sa musique, ce qui se ressent également dans ses mixes sur NTS, dans ses lives, plus encore dans son album, qui fait l’éloge à la fois de l’introspection et du collectif, de l’individualité et de l’unité. Quand on lui demande si cela lui importe d’être la meilleure version d’elle-même, ou si elle préfère laisser les choses se passer de façon organique, on y retrouve ces deux faces d’une même pièce. « Pour moi, ce n’est pas l’un ou l’autre, ces choses existent au même moment, sur le même spectre, et ont pour même but une honnêteté totale envers ma musique. »
Pa Salieu (UK)

Quelle que soit la réalité que recouvre le terme « hip-hop » en 2020, il n’est en tout cas plus américano-centré. Pas non plus jusqu’à dire que le Royaume-Uni en est devenu le nouvel épicentre, mais presque. C’est en tout cas de là que sont puisées les influences drill, entre autres, qui irriguent désormais tout le rap US ou même français. Mais cantonner le jeune Pa Salieu au seul hip-hop ne lui ferait pas honneur. Absolument inconnu au bataillon jusqu’à cette année, il l’attaque dès le 2 janvier par un tube imparable, « Frontline », sombre et rentre dedans, au flow impeccable et acéré. Viennent d’autres singles, le fabuleux « Betty » notamment, et on lui colle trop rapidement une étiquette afrobeat qui convient pourtant mieux à J Hus et Burna Boy, à qui on l’accole inlassablement. Pourtant, ces deux-là s’aventurent rarement sur les chemins plus durs qu’arpente Pa Salieu, sans vaciller. « They don’t know about the block life », c’est la marotte de « Frontline », lui qui est originaire de Coventry, banlieue pauvre de Birmingham. Send Them To Coventry, le titre de sa mixtape en forme de premier Greatest Hits, est d’ailleurs une expression anglaise qui signifie ostraciser quelqu’un, l’ignorer, le rendre invisible. Pa Salieu s’érige comme porte-parole de ceux-là. Mais s’adresse aussi aux bourreaux. « Send the to Coventry », ils vont voir ce qu’ils vont voir.







