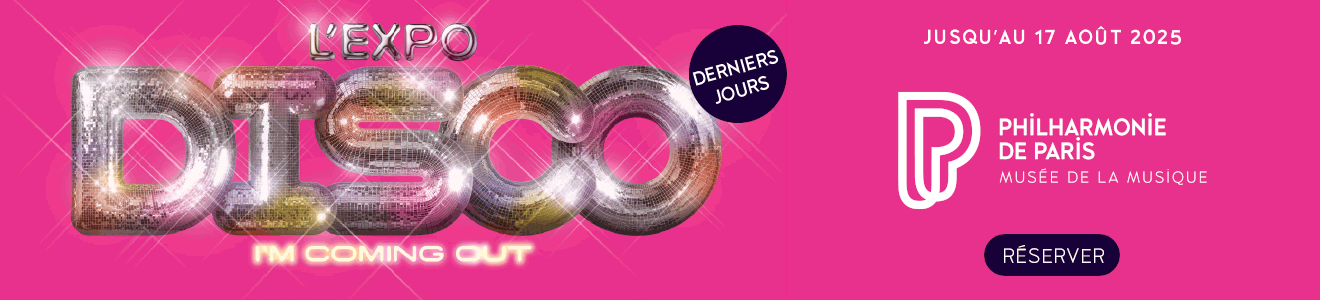Odyssées sonores et bonnes chansons ne vont pas toujours de pair. Chez Tame Impala, si, et c’est sans doute ce qui a conduit le groupe australien au triomphe. Alors que le groupe s’apprête à se produire le dimanche 28 septembre au festival Rock en Seine à Paris pour défendre l’impressionnant Currents, rencontre avec Kevin Parker à Austin, Texas. Sous la pluie.
Depuis son premier EP sorti en 2008 sur le label australien Modular et la furieuse bombe psyché “Half Full Glass Of Wine”, Tame Impala a vu l’avenir s’ouvrir pour lui sur la planète indie rock. Mais son deuxième album, Lonerism, sorti fin 2012, a fait passer le groupe dans une catégorie qu’on ne lui pensait pas accessible. Presque un million de fans Facebook, une tournée interminable à travers le monde (dont un Olympia à Paris), une omniprésence dans les classements de fin d’année et une nouvelle stature : avec Grizzly Bear ou MGMT, Tame Impala fait désormais partie de ceux qui nagent au-dessus des autres. Deux ans et demi plus tard, sans pression, Kevin Parker, l’homme qui contrôle l’Impala (il compose et enregistre seul, fait même les lumières) revient avec Currents, un album qu’il a pour la première fois produit seul, chez lui à Perth et poursuit son autorévolution. En ligne de mire, la pop, qu’il convoite en s’éloignant du rock et du psychédélisme et en s’ouvrant, plus direct, plus frontal. Un disque bourré de moments de bravoure qui doivent plus à MGMT (tiens donc) ou à Daft Punk qu’aux héros psyché seventies, de “Let It Happen” à “New Person, Same Old Mistakes”. Alors que le groupe a joué pour la première fois à l’Austin Psych Fest, on retrouve monsieur Parker dans le salon du dixième étage du Hilton Garden dans le centre d’Austin. Sous la grande verrière impressionnante, le timide Kevin se détend, peu à peu, malgré l’approche de plus en plus menaçante d’une tornade.
À la sortie de votre second album Lonerism en 2012, tout s’est emballé, médias, public… Comment as-tu vécu ce succès mondial ?
Je ne considérais même plus ça comme le cycle du second album tant ça durait, encore et encore. On a tourné aux États-Unis, puis en Amérique du Sud, en Europe, en Australie et quelques mois plus tard il fallait déjà refaire tout le circuit. Je n’ai pas trop compris comment tout ça marchait, ce que je sais c’est que les salles étaient de plus en plus grandes. En voyant les dates s’aligner le sentiment est toujours un peu mitigé. Je suis très inspiré par le live, faire évoluer les chansons, triper sur les lumières. Mais je me sentais déraciné et puis c’est dur à gérer avec nos copines. Et ça me rend fou de ne jamais dormir deux fois dans le même lit. Tu sors de ta chambre d’hôtel et tu n’y remettras jamais les pieds, c’est comme ça tous les jours. Cette idée me fait mal au crâne.
Tu parles de la création lumières, il paraît maintenant que tu as une pièce entière consacrée à ça chez toi ?
Oui, dans la maison que je me suis achetée à Perth, ma ville d’origine, il y a moins d’un an. C’était un bon moyen d’oublier toute la gueule de bois de tournée et de me recréer un chez-moi. (il sort son iPhone pour montrer une vidéo du processus de création des lumières) Je pète complètement les plombs à force, c’est une petite pièce, en plus j’ai une machine à fumée qui déglingue un peu mon cerveau, je crois.
Tu as compris pourquoi Lonerism avait rencontré un tel succès ?
J’en suis fier, évidemment, mais ça m’a pris du temps. Quand j’ai fini Lonerism je le trouvais chiant et je pensais que notre label avait secrètement payé tous les magazines pour qu’ils écrivent des chroniques élogieuses, j’en étais persuadé. Ça prend peut-être deux ans pour que je puisse apprécier les choses.
Et ce troisième, Currents, tout juste fini, tu le trouves comment ?
Je ne sais pas… Si je l’écoutais, je me servirais sûrement pas mal de la zapette (rires).
Tame Impala a pris tellement d’ampleur qu’un site chilien avait déclaré que ta chanson “Feels Like We Only Go Backwards” était un plagiat d’un chanteur argentin.
Je l’ai compris comme une blague, plutôt drôle, j’ai écouté le morceau du mec et je trouvais que ça ressemblait plutôt à “La Bamba” (rires). Ca m’a juste un peu énervé parce que ce jour-là on annonçait notre tournée, on essayait d’inciter les gens à acheter des places et cette histoire a fait de l’ombre à notre annonce.
La blague est allée loin ?
En découvrant ça le chanteur avait déclaré songer à porter plainte mais ça s’est arrêté là. Mon manageur m’a dit qu’il voulait probablement se faire de la pub parce qu’il n’avait pas eu de succès depuis l’enfance.
Tu as bientôt 30 ans (en janvier prochain), il y a quinze ans, quel était ton rapport à la musique ?
Depuis mes 12 ans, la musique a pris le pas sur toute ma vie, accaparé tout mon cerveau, mes parent me disaient “la musique c’est fun mais ne crois pas que tu vas pouvoir en faire de l’argent”. Mon père était musicien mais avait aussi un job de bureau. Il me parlait de ses amis musiciens, de leurs problèmes d’argent, du fait qu’ils devaient faire de la musique qu’ils n’aimaient pas pour gagner de l’argent : qu’en faire son métier tuait la magie. C’était évidemment plus fort que moi, le désir de créer, c’est un tel accomplissement.
À cet âge-là, tu avais quel genre de plans en tête ?
Je voulais être une rock star, faire des truc de rock star, les filles, le pouvoir, la classe infinie, etc. J’ai vite compris que c’était un cliché immature. À 15 ans, j’expérimentais. Mon frère m’avait offert un CD de Radiohead, j’ai compris que la musique n’était pas forcément composée que d’instruments. J’enregistrais les sons des outils du garage, le train qui passait et je faisais de la musique sans aucune règle. C’est l’avantage de n’avoir aucun spectateur, j’étais libre.
Au lycée, tu étais le rockeur cool ?
Non j’étais le mec débraillé. Le rock n’était pas cool. Les mecs cool de l’école, c’était les sportifs et ceux qui descendaient les canettes de bière. J’étais pas mauvais en bière, très mauvais en foot.
Ton père faisait partie d’un groupe de reprises, tu es aussi passé par là ?
Avec Dominic, qui joue toujours de la guitare et du synthé dans Tame Impala, on a beaucoup fait des trucs de grunge ou de punk… du Rage Against The Machine et pas mal de trucs plus honteux.
Tu as tenté la fac. Ton père avait réussi à te décourager ?
J’avais pris conscience que vivre de la musique est un fantasme. Viser cela c’est comme viser de gagner au loto. Et à cet âge-là, vers 20 ans, mes amis et moi n’en étions plus à vouloir faire de la musique pour la gloire et l’argent, on ne pensait plus à ce que le monde nous écoute. Mes artistes préférés étaient inconnus, alors comment pouvais-je espérer devenir célèbre ? Même Neu! ou Can ne sont devenus des légendes qu’après leur temps. Alors j’ai commencé à étudier l’astronomie. Mais si à l’école tu es obligé d’être en cours, à la fac tu dois te responsabiliser… c’était sans espoir (rires). Je n’y allais jamais ou alors en cours je voyais les chansons naître dans ma tête. Six mois après le début de l’année on a signé avec Modular. Adios, l’école !
Finalement ta réussite a-t-elle tué une part de la magie que tu mettais dans la musique ?
J’ai eu peur au début. Le label mettait pas mal de pression, le fait d’avoir un public me mettait de la pression. Mais ça n’a pas tué la magie. Quand j’ai commencé à faire de la musique je ne savais pas ce que je faisais, c’était mystérieux. Dès que j’ai appris et compris, j’ai troqué le mystère contre le savoir. Il faut trouver le mystère ailleurs.
Ce fut facile de te mettre à écrire un nouvel album ?
Pendant longtemps, deux ans, mon énergie était trop ponctionnée par la tournée. Quand on a arrêté de tourner, mon plan c’était ne plus penser à la musique, jouer aux jeux vidéo, me bourrer la gueule… mais dès que la pression s’est évanouie, que je me suis dit que faire un troisième album ne pressait pas, les idées ont afflué.
Cette maison que tu as achetée représentait-elle le début d’une pause ?
Non parce que je l’ai achetée justement pour m’installer un studio, jusqu’à présent je partageais une maison avec des colocataires, c’était infernal. Là, la maison fait trois pièces, deux pour la musique, une pour les lumières (rires).
Ta petite amie doit apprécier !
Elle comprend (rires).
Il paraît qu’en studio de répétition, vous étiez entourés de stars…
On était coincés entre No Doubt et Paul McCartney. (il s’interrompt, la pluie commence à s’abattre violemment sur la verrière)… oh merde !
Il y a une tornade pas loin dans le Texas.
T’es sérieux ? Mais on joue ce soir, en extérieur ! Bref, en studio de répète on blague toujours sur ce qu’on pourrait dire à ces stars. Julian a parlé avec McCartney, on était sacrément jaloux. On ne pensait pas qu’on pourrait l’approcher. Mais il traînait là, simplement, sans gardes du corps. J’ai fait la queue aux toilettes avec lui… grand moment. Par contre je crois que Gwen Stefani n’était même pas là. Quand ton groupe fait les répétitions sans toi c’est que tu es une vraie star.
Vous jouez au Austin Psych Fest, mais Tame Impala n’a jamais été aussi peu psychédélique.
C’est vrai, tiens. Mais nos lumières sont très psychédéliques et on ne joue que peu de nouvelles chansons. On nous a toujours dit que ce festival était incroyable.
Vu le nom, on imagine un public particulièrement perché.
Pourtant je suis sûr que ce sera la foule la plus sobre. Regarde, les musiciens les plus drogués font souvent la musique la plus simple. Les Grateful Dead, acid heads complets, faisaient de la country toute simple. Wayne Coyne des Flaming Lips est un mec assez sobre, alors que sa musique est ultra-tripée.
Tu es plutôt catégorie Wayne Coyne toi ?
Plutôt oui. Je fume de l’herbe mais je n’ai pas pris d’acide depuis un moment, pas de champis depuis un an je crois. Mais être stone et faire de la musique peut-être une chose assez excitante.
Où sont les foules les plus folles ?
En Amérique du Sud, tout le monde chante chaque note, y compris les lignes de basse et les guitares.
Sur disque, tu assumes de plus en plus tes ambitions pop ?
J’adore la pop. Longtemps je l’ai considérée comme taboue, je la voyais comme un plaisir coupable, en plastique, jetable. Mais plus j’y pense, moins je comprends pourquoi l’art-rock ou la musique expérimentale sont considérés comme plus intellectuels. Je pense même que ça requiert plus d’intellect de faire une bonne chanson pop que d’aller dans l’expérimentation, à l’aveugle.
Si Katy Perry venait te demander de produire ses morceaux…
Je me précipiterais ! C’est le côté de la musique qui m’intrigue le plus. Je peux te refaire un album de rock psychédélique en deux secondes, ça je maîtrise. Je peux faire du crade, des guitares rugissantes, du son qui crépite. Mais faire la parfaite pop song, maîtriser ce style plus produit, plus direct, ça je ne sais pas faire.
D’ailleurs ta voix aussi est de plus en plus centrale et moins traitée, sur disque. Tu la bosses ?
(rires) Non je ne m’échauffe jamais la voix, je bois et je monte sur scène à dégobiller les paroles. Je crois que ça va devoir changer et ça me fait flipper et rire à la fois de devoir m’échauffer. Je pensais que c’était réservé à Céline Dion.
L’album est assez léger, estival, mais il paraît que c’est un album de rupture.
Ce n’en est pas un, mais l’album parle de sentir une force invisible qui te pousse à repartir de zéro. (la pluie tambourine encore plus) Wahou, c’est excitant cette pluie ! C’est un album qui parle d’une transition personnelle, de passer à autre chose. Alors il y a une part de rupture là-dedans, des gens et des choses que tu laisses derrière, compagne, amis, endroits.
C’est dur de puiser dans des choses aussi personnelles ?
C’est devenu un peu plus facile. À l’adolescence je faisais des trucs très personnels, mais dès que j’ai su que j’avais un public ça m’a complexé, intimidé. J’ai grandi dans un monde très masculin, à la maison je vivais avec mon père, mes deux frères et ma belle-mère, parler sentiments n’était pas vraiment accepté. Maintenant j’ai pris confiance.
Tu es très présent sur le dernier album de Mark Ronson, le producteur de stars mainstream (Adele, Amy Winehouse, Christina Aguilera), comment est-ce arrivé ?
On s’est rencontrés à un festival, en Australie, je bloquais sur lui et lui est venu me voir pour me dire qu’il aimait ma musique, ça m’a tué. Un jour il m’a demandé de chanter sur deux chansons. J’ai aussi enregistré quelques instruments, puis lui ai envoyé un morceau un peu funky qu’il a aussi utilisé sur son album (“Daffodils”, ndlr).
Tu te retrouves donc sur le même album qu’“Uptown Funk”, le deuxième tube resté le plus longtemps n°1 dans l’histoire des charts américains.
C’est assez drôle… Je n’ai jamais été impliqué dans quelque chose d’aussi gros. C’est surtout une preuve que de la musique qui vend des tonnes peut être faite de manière humaine, avec un processus naturel, des gens honnêtes, etc.
Tu as produit Currents seul, mais l’as-tu fait écouter à Ronson par exemple, lui qui est si influent dans le monde pop ?
Je voulais mais je n’ai pas eu l’occasion. Je fais toujours écouter à Dom et à ma copine, parce que les autres mecs du groupe ne vivent pas à Perth et je n’aime pas envoyer ça par email, je veux voir leurs têtes quand ils écoutent, je veux être dans la pièce.
C’est vicieux !
C’est encore plus dur pour moi en fait (rires).
Et alors ? Tu arrives à tout lire sur leur visage ?
Je croyais savoir faire ça mais en fait je suis un peu parano, j’interprète n’importe comment. La plupart du temps ils me disent qu’ils aiment et je leur réponds “vraiment ? T’as attendu la fin de la chanson pour le dire, pourquoi tu l’as pas dit plus vite ? C’est quoi ton beat préféré ?”. En fait, ce processus ne sert à rien (rires).
Certains titres et des voix font penser aux Daft Punk. Une comparaison qui a du sens pour toi ?
J’espère, je l’accueille avec plaisir, j’ai toujours aimé Daft Punk, pour moi le groupe est un des sommets de la musique, entre disco-funk vintage et concepts futuristes.
Tu as vécu à Paris d’ailleurs, quelles étaient tes activités préférées ?
En général je prenais un Vélib et je me perdais dans la ville, ou alors je me rendais sur des lieux touristiques, la maison de Serge Gainsbourg par exemple. Un vrai touriste. Ma copine de l’époque, française (Mélody de Melody’s Echo Chamber, ndlr), m’a vraiment fait adorer Gainsbourg ou Françoise Hardy.
Un morceau du nouvel album s’appelle “Cause I’m a Man”, on t’y entend chanter “Cause I’m a man, woman/ Don’t always think before I do” et il a suscité quelques réactions négatives…
Les paroles sont assez directes, mais aussi trompeuses. En surface c’est une chanson où je m’excuse de n’être qu’un homme, un salopard, un cochon. Mais c’est aussi une lamentation sur le fait qu’en tant qu’humain on est fondamentalement incapable d’être insensible, toujours vulnérable. J’étais sûr que je me ferais traiter de misogyne. Mais si tu as peur de froisser avec ton art tu ne feras que des trucs chiants.
Article paru dans le Tsugi n°83.