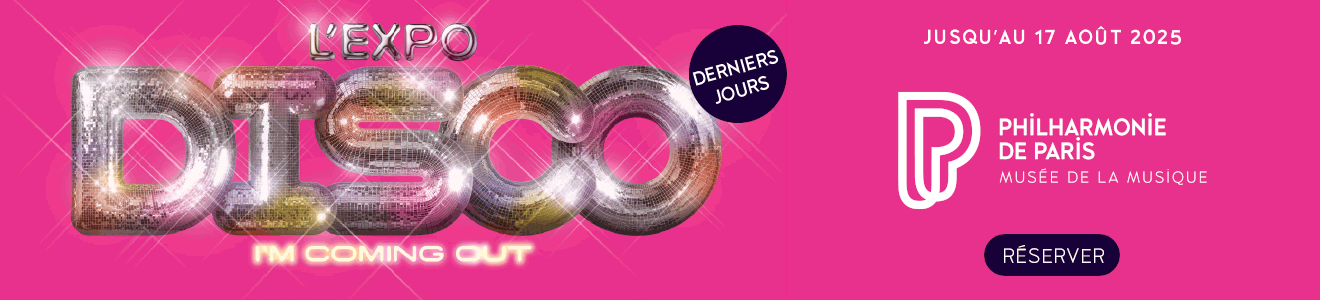Dix ans après son album/compilation Damaging Consent, Christophe Monier réactive son projet The Micronauts avec un troisième étonnant et abouti, qui réalise le grand écart parfait entre acid house, sound design et ambient menaçant. Réflexions – entre autres – sur les affres de la création et le statut de l’artiste au XXIe siècle avec un producteur présent depuis les débuts de la scène électronique française.
Et si vous êtes plutôt Spotify :
Peut-on dire que tu n’es pas très productif, avec seulement trois albums publiés en 18 ans ?
C’est vrai et c’est un peu mon drame. J’ai perdu beaucoup de temps dans ma vie à me battre contre mes démons. Maintenant qu’ils sont à peu près sous contrôle, je m’aperçois qu’il est très difficile de dégager du temps pour faire de la musique. Les interruptions involontaires, dues à la vie, font perdre le fil de la pensée. Celui-ci est souvent long, voire impossible à retrouver plus tard. C’est un combat permanent. Il faut gérer les sollicitations en tout genre, les obligations sociales, les responsabilités qui augmentent avec le temps, les impératifs professionnels qui, à mesure que les revenus de la musique enregistrée ont baissé, n’ont fait que se multiplier. Aujourd’hui, un compositeur-producteur tel que moi doit faire beaucoup plus de choses par lui-même, car il ne peut plus payer tous les professionnels qui auparavant géraient les différents aspects de sa carrière (de la promo à la compta en passant par le mixage, le management ou le juridique). Il faut ajouter la technologie qui évolue et qu’il faut suivre, avec son lot de bugs et d’incompatibilités qui imposent souvent de refaire ce qui a déjà été fait. Sans parler des réseaux sociaux sur lesquels il faut faire acte de présence et des plateformes sans cesse changeantes auxquelles il faut en permanence s’adapter. Enfin, plus une carrière dure, plus la quantité de temps passé à la gérer est grande et chronophage.
Ce rythme de production te convient ou tu aimerais en faire plus ?
Je rêverais de faire plus de musique et moins de tâches annexes. J’envie les artistes qui ont su trouver un directeur artistique et un label qui leur font confiance et les accompagnent tout au long de leur carrière.
Du point de vue qualitatif, tu sembles toujours aussi maniaque du son. Passes-tu des heures sur chaque élément sonore de tes productions ?
Ça dépend de ce qu’on entend par “élément”, mais au final, je passe effectivement des heures et des heures sur mes morceaux. Je choisis mes sons assez rapidement, de manière instinctive. Puis je compose en temps réel, en les jouant et en improvisant. Les idées musicales viennent ainsi, quasi instantanément. Mais tout n’est pas bon. Je passe ensuite énormément de temps à sélectionner les meilleurs éléments, à leur assigner un rôle dans le morceau, une place dans l’espace sonore puis à les structurer. Je perds aussi pas mal de temps sur certains aspects techniques qui me sont moins naturels tel le mixage. De plus, j’aime bien laisser reposer une fois qu’une étape a été achevée, oublier pour réécouter quelques jours plus tard avec des oreilles fraîches et faire les ajustements qui s’imposent alors comme une évidence. Je l’ai aussi fait pour l’album dans son ensemble. Alors qu’il était apparemment terminé, j’ai pris plusieurs mois pour éliminer le gras. C’est allé de supprimer des pistes ou des effets à droite à gauche jusqu’à supprimer des morceaux entiers, en passant par couper des mesures et raccourcir là où c’était possible. Ça me semble être la moindre des choses. Il ne faut plus ajouter de bruit de fond au bruit de fond, celui qui cache l’information utile au sens de la théorie de l’information. Cet album est un acte de résistance à l’injonction contemporaine à produire vite, beaucoup, sans trop se soucier de qualité, dans le but de maintenir une présence et d’avoir toujours de l’actualité.
Tout ceci expliquerait-il les dix ans qui se sont écoulés depuis Damaging Consent ?
En partie seulement. J’ai eu un fils. J’ai pas mal tourné pendant deux-trois ans après la sortie de Damaging Consent. Puis j’ai fait de la musique avec d’autres artistes pour me changer les idées et me renouveler. Ensuite il a fallu mettre de l’argent de côté je voulais pouvoir me consacrer uniquement à mon album, quitte à mettre ma carrière entre parenthèses. J’ai donc travaillé pour d’autres, comme réalisateur, remixer, ingénieur du son. J’ai réduit le plus possible mon train de vie et j’ai vécu sur mes économies le temps de la création et du lancement, qui sont entièrement autofinancés.
Au final, combien de temps as-tu passé sur ce nouvel album ?
J’ai décidé de m’y consacrer exclusivement il y a trois ans. Mais en vrai, c’est difficile à dire. Outre ce que je raconte plus haut, j’ai aussi abondamment puisé dans ma réserve d’idées, d’impros, de sons que je crée et mets de côté dès que je m’amuse avec un instrument ou un logiciel. Certains remontaient aux années 2000. Le temps de la création, c’est le temps de la vie.

Si ma mémoire est bonne, ton studio s’appelait l’atelier de musique électronique. C’est un parti pris de se considérer comme un artisan du son ?
C’est vrai, j’avais pris l’habitude de l’appeler comme ça, avec un  accent circonflexe, un M et un E en majuscule pour donner ÂME. Ce n’était pas très réfléchi. C’était plus un jeu, un truc en français à mettre sur les notes de pochette, en référence à ces spécialités françaises que sont la mode et la haute couture, à une époque où la musique française n’était pas prise au sérieux internationalement. Je ne considère absolument pas devoir faire preuve de fausse modestie parce que je fais de la musique électronique et informatique. Au contraire je pense que cette musique s’inscrit pleinement dans l’histoire de la musique, et donc de l’art. À nous les artistes de faire en sorte qu’elle continue à s’y inscrire en restant personnels et créatifs, en ne devenant pas des marchands, tels que définis par Guy Debord dans La Société du spectacle, qui reproduisent à l’infini des recettes inventées par d’autres.
Tu as connu les majors et les sorties internationales en 1998 avec le single “The Jag” et en 2000 avec l’album Bleep To Bleep, te sens-tu aujourd’hui libre et maître de ton destin avec ton label Micronautics ?
C’est certain. Deux fois dans ma vie, j’ai signé en direct avec des majors : Impulsion (son duo avec Pascal R, ndr) avec Sony France et The Micronauts avec Virgin UK. À chaque fois la liberté de création était totale, je n’ai jamais rencontré le moindre souci de ce point de vue. Les directeurs artistiques qui avaient initié ces signatures l’avaient fait en connaissance de cause, parce qu’ils aimaient vraiment la musique. Ils protégeaient des pressions tout en fournissant des moyens considérables, sans commune mesure avec ceux disponibles en indépendant. Mais aujourd’hui, cette musique, que j’ai pourtant produite, ne m’appartient plus. Les morceaux sont certes disponibles sur les plateformes digitales, mais de la mauvaise manière, avec plein d’erreurs. Les équipes ont été renouvelées de multiples fois. Virgin a été racheté par EMI puis par Universal. Je ne sais tout simplement pas qui contacter pour les corriger, même s’il faudra bien que je m’en occupe un jour… Dans le cas de The Micronauts par exemple, l’article “The” est souvent oublié du pseudo et des titres, ce qui crée des problèmes de référencement. Le mastering est pourri et mériterait d’être refait. “Baby Wants To Bleep”, le premier morceau du mini-album Bleep To Bleep, présenté sur les supports physiques de l’époque comme une suite en quatre parties alors que le son ne s’arrête pas et qu’il s’agit réellement d’un seul morceau en un seul tenant (quatre indexes sur le CD, quatre plages visuellement identifiées sur le vinyle par un écartement plus grand du sillon, un clin d’œil aux “disco eye-cues” des maxis club des années 70, qui séparaient visuellement parties chantées, instrumentales et breaks) est rendu disponible sur les plateformes digitales en quatre petits bouts indépendants. C’est un contresens total. Ça me fend le cœur, car je place “Baby Wants To Bleep” et “The Jag” parmi mes meilleurs morceaux. Ceux que ça intéresse trouveront sur mon SoundCloud “Baby Wants To Bleep” d’un seul tenant et un remastering de “The Jag” que j’ai fait en 2012 pour moi et pour les potes.
Head Control Body Control est le plus abordable à ce jour. Est-ce quelque chose à laquelle tu avais pensé dès sa conception ?
Au moment où je me suis remis à produire en tant que The Micronauts, je me suis aperçu qu’un certain nombre de morceaux n’étaient pas vraiment dancefloor, et, de ce fait, pas vraiment adaptés à une sortie en single ou sur un EP. C’est même ce qui m’a poussé à envisager un album. C’est peut-être aussi ce qui le rend plus accessible. Les moments de forte intensité physique sont contrebalancés par des moments plus calmes et dépouillés, rendant l’ensemble plus équilibré et plus digeste. À l’inverse, le mini-album Bleep To Bleep est principalement formé de deux titres, “Baby Wants To Bleep” et “Bleeper”, initialement prévus pour un maxi. C’est dans l’Eurostar pour Londres où on allait les faire écouter à la maison de disques que j’ai eu l’idée d’en faire un concept-album, en y ajoutant des impros et des expérimentations qu’on n’avait pas réussi à intégrer aux deux morceaux principaux. L’album Damaging Consent, lui, correspond plus à une compilation de singles et de EPs édités ou remixés, liés par des interludes.
Entre Damaging Consent et Head Control Body Control, le tempo général a bien baissé, tu t’attaques à des terrains plus posés, voire ambient… Est-ce dû à une envie d’expérimenter des champs sonores plus larges, ou, sans méchanceté, avancer en âge te pousse vers des sons moins ravageurs ?
J’avais en effet envie d’expérimenter des champs sonores plus larges et de faire un album en phase avec mes goûts musicaux qui sont réellement “trans-genres”. J’écoute et puise mon inspiration dans tous les styles de musique électronique, pas seulement la house et la techno. Quant à l’âge et l’expérience dont tu parles, j’ai l’impression qu’ils rendent plus exigeant. J’élimine beaucoup plus qu’avant.
“Acid Party”, le premier single, est un hommage aux sons acid des débuts et à un certain lâcher-prise des raves passées. L’acid house constitue-t-il une partie importante de ton héritage musical ?
C’est exactement ça. D’une part il procède d’un hédonisme révolutionnaire revendiqué. D’autre part, il rend hommage à l’acid house de Chicago qui m’a procuré un véritable choc esthétique la première fois que j’en ai entendu. C’était la musique que j’attendais depuis toujours, celle qui réussissait à combiner le groove de la musique noire américaine, la sauvagerie du rock, l’avant-gardisme abstrait de la musique contemporaine. C’était en 1988 et c’est le moment où j’ai compris que plus rien ne serait comme avant l’avenir de la musique était là, dans cette nouvelle musique électronique apparue simultanément à Chicago, la house, à Detroit, la techno et à New York, le garage.
Head Control Body Control est-il ton disque le plus personnel ?
Il correspond précisément à ce que je suis actuellement, mais beaucoup de mes productions précédentes étaient tout aussi personnelles. En revanche, j’ose en dévoiler plus, aidé en cela par son format album et libéré par sa sortie sur mon label où je suis le seul maître à bord.
Complète : Head Control Body Control est…
Inspiré d’une des expressions favorites d’un de mes profs de sport de combat “Qui contrôle la tête contrôle le corps.” Si tu immobilises la tête de ton adversaire, il ne peut plus grand-chose contre toi. Un peu comme le capitalisme empêche la masse des gens de se révolter en l’immobilisant devant sa télé ou son smartphone.