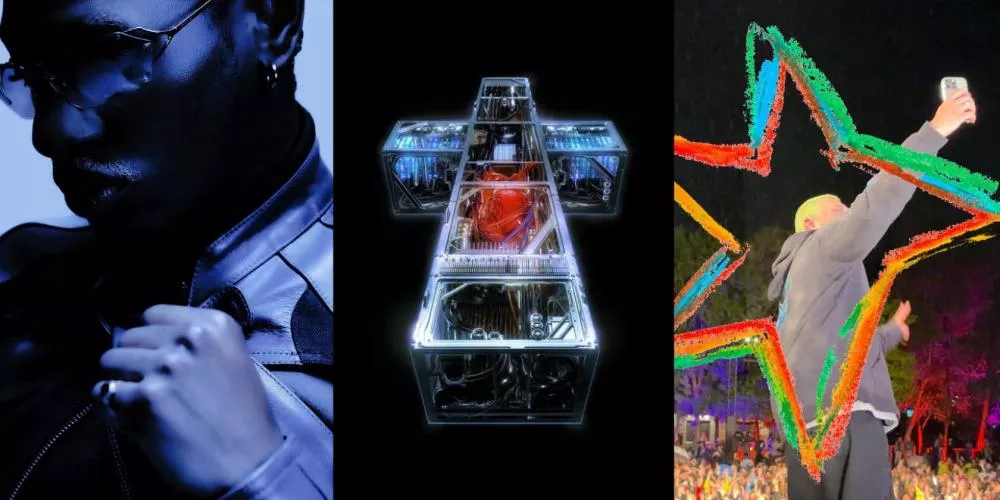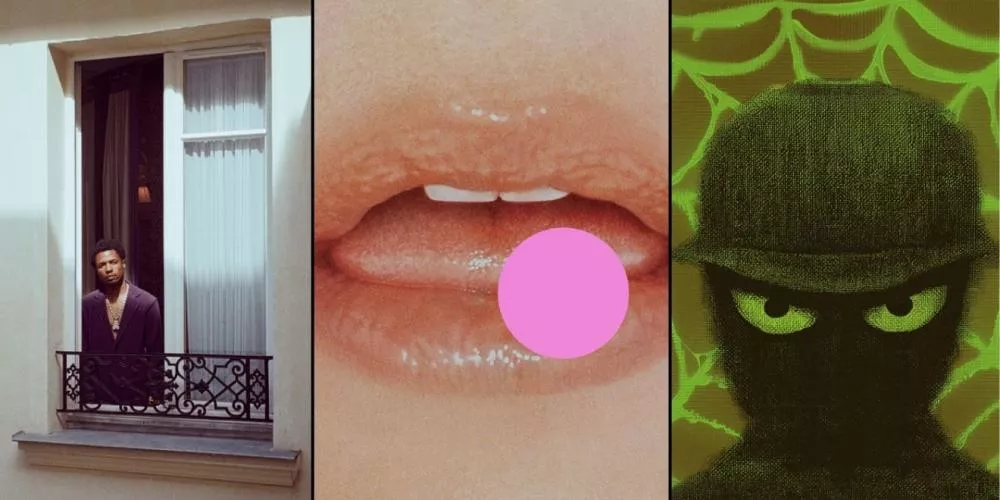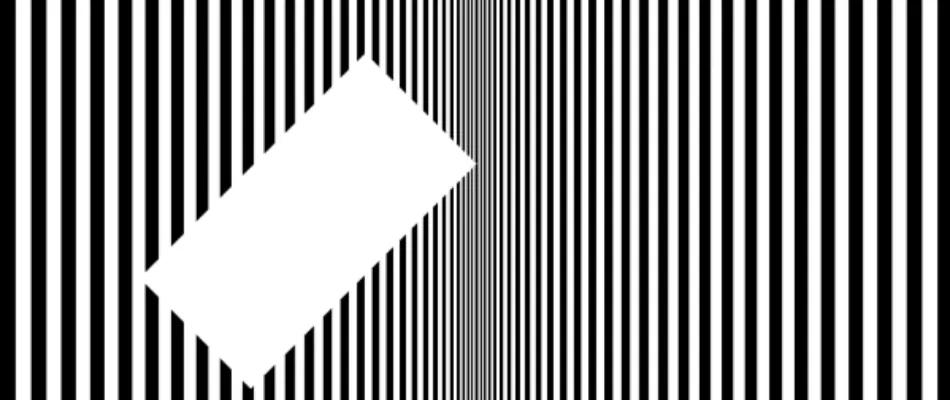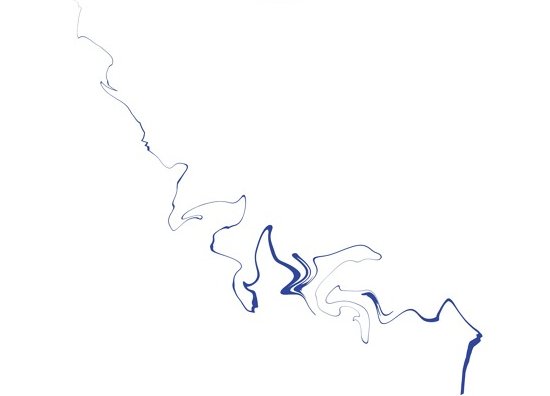On peut être l’un des producteurs les plus talentueux de sa génération et se retrouver assailli par le doute, créer une musique limpide et virevoltante, mais travailler dans la douleur, faire du surf et s’habiller en noir. Presque une forme de malédiction. Pourtant, Jamie XX, qui vient de sortir son deuxième album solo, neuf ans après le premier, n’oublie pas de rappeler qu’il est un homme chanceux : il vit de sa passion et la plupart de ses contraintes sont celles qu’ils s’imposent.
Article issu du Tsugi Mag 173, écrit par Gérome Darmendrail
Avec sa grande carcasse et sa chevelure dense, il pourrait en imposer, mais il semble au contraire vouloir se faire plus petit qu’il ne l’est, posture légèrement voûtée et regard vers le bas. Jamie Smith pénètre discrètement dans les locaux de Beggars, antenne parisienne de sa maison de disques, de retour d’une séance d’essayage chez une maison de haute couture. On lui a prêté des vêtements pour une soirée organisée par Radio France le lendemain à l’Olympia, dans le cadre de la fête de la Musique, où il jouera en compagnie de Justice, Yamê et Luidji.
Voir cette publication sur Instagram
Il salue l’assistance d’un hochement de tête, traverse l’open space et file s’installer dans un salon dédié aux interviews. Un exercice pour lequel il n’a pas la réputation d’être « un bon client ». Plus par timidité que par désintérêt, faut-il préciser. Être dans la lumière n’a jamais été sa lubie, tant bien même il n’a eu de cesse, depuis le début de sa carrière, de l’attirer. D’abord au sein de The xx, groupe rock avant-gardiste et raffiné lancé à la fin des années 2000 en compagnie de Romy Madley Croft et Oliver Sim, deux camarades de classe guère plus à l’aise avec les projecteurs, rencontrés sur les bancs d’un lycée londonien, la fameuse Elliott School.
Architecte sonore du groupe, il fut le premier à s’en émanciper en sortant en 2015 un album solo remarquable, In Colour, s’écartant du style sombre et post-punk de The xx pour lui préférer des sonorités dansantes et tropicales, sans se départir d’une mélancolie persistante.
Un succès critique et commercial resté longtemps sans lendemain. S’il ne s’est pas montré inactif depuis, accouchant en 2017 d’un troisième album avec The xx et donnant un coup de main à Oliver et Romy pour leurs projets solo respectifs, il s’est contenté, sous son nom, de quatre singles en l’espace de neuf ans. Une rareté qui n’a pas entamé son crédit. Au contraire. Son deuxième album, In Waves, est l’un des plus attendus de la rentrée. Et peut d’ores et déjà prétendre au titre de disque de l’année.
On imagine que tu connais bien Paris. Il y a des endroits où tu aimes te rendre quand tu es ici ?
Hum, ça change tellement vite… Je venais souvent à Paris quand j’avais 16 ans pour faire du skate. Parce que c’est très facile de venir depuis Londres, et parce qu’il y a une vraie culture skate ici, avec plein de spots. J’allais souvent autour des Halles ou sous la Grande Arche.
Tu continues le skate ?
Non, je suis trop vieux… (sourire) Bon, allez, de temps en temps, mais le problème du skate, c’est que ça laisse trop de séquelles.
Il paraît qu’on se blesse souvent, en effet, même quand on est bon.
Exactement. Pendant la pandémie, j’avais repris un peu, parce que j’avais du temps, mais je suis passé au surf. C’est plus facile à vivre pour mon corps.
Mais moins facile à pratiquer quand on vit en Angleterre. Où vas-tu surfer ?
À Biarritz. J’y vais plusieurs fois par an. J’aime beaucoup. J’ai d’ailleurs prévu d’y aller demain, pour y passer deux jours.
Tu pourras peut-être y retourner durant l’été, tu n’as pas l’air d’avoir trop de dates.
Oui, ce sera un été beaucoup moins chargé que ces dernières années. Mon album sortant en septembre, c’est après la sortie que les dates vont s’enchaîner. Ça tombe bien, j’ai travaillé très dur pour terminer ce disque, j’ai besoin de faire un break.
En janvier 2023, tu avais annoncé que ton album était en phase de mixage. Que s’est-il passé entretemps ?
Cet album, j’ai pensé l’avoir fini au moins huit fois. Je suis sérieux. À chaque fois, j’en étais vraiment certain. Et puis je
commençais à me dire que je pouvais faire mieux, donc je m’y remettais encore et encore… Je n’ai jamais mis autant de temps
à finir quelque chose. J’en suis arrivé au point où je ne pouvais tout simplement rien faire de plus. J’étais arrivé au bout. Ce qui
est finalement un sentiment satisfaisant.
Ce besoin de refaire et refaire, tu l’avais déjà ressenti sur le premier album ?
Pour tout dire, j’avais été un peu déçu par le mixage de In Colour. Ça m’avait même contrarié. J’ai vu In Waves comme une seconde chance. Toutes les choses que j’avais regrettées sur ce premier disque, je pouvais les corriger sur celui-là.
« J’ai pensé avoir fini In Waves au moins huit fois. À chaque fois, j’en étais vraiment certain. Et puis je commençais à me dire que je pouvais faire mieux, donc je m’y remettais encore et encore… Je n’ai jamais mis autant de temps à finir quelque chose. »
Il y a quelques années, tu as dit que tu avais fait ton premier album uniquement pour te forcer à finir « un paquet de morceaux ». Est-ce une raison similaire qui t’a poussé à faire celui-là ?
Je ne me souviens pas avoir dit ça, mais ça me semble logique. Le début de la création d’un morceau est toujours la partie la plus marrante. Les idées jaillissent, ça fuse. Mais quand vient le moment de le finaliser, de le structurer, de travailler les détails, ça devient méticuleux, chronophage, surtout quand tu es seul. Tu passes ton temps à faire des allers-retours dans ta tête. Des milliers de fois, parfois. Donc c’est bien d’avoir un objectif et une deadline.
Tu ne t’appuies pas sur un avis extérieur lorsque tu composes ?
Arrivé à un certain stade, si. Je joue les morceaux dans des petits clubs, des gros festivals, et j’observe la façon dont réagit le public. Je modifie la musique en fonction. Le public a clairement été impliqué dans la conception de cet album.
In Waves est plus dansant que In Colour.
Le premier était dansant aussi, mais avec du recul, il est évident que celui-ci est plus orienté club. Je pense que le fait de beaucoup jouer en club, d’avoir appris à vraiment aimer le deejaying, m’a poussé à aller dans cette direction de façon naturelle. Et puis bien sûr le fait de me nourrir du public en testant mes démos. Le disque a fini par sonner comme un de mes DJ-sets.
Entre les deux, tu n’as pas sorti beaucoup de musique. C’était voulu ?
J’ai quand même composé le troisième album de The xx, j’ai aussi travaillé sur l’album de Romy… Mais en réalité, j’ai
apprécié ne pas être dans le rush. Je n’avais pas de raison de me presser. En tant que DJ, tu n’es pas forcément obligé de sortir des choses. J’ai eu la chance de pouvoir tourner durant les dix dernières années en me contentant de sortir très peu de musique.
Ça ressemble à un luxe à l’heure des plateformes de streaming, la plupart des artistes semblant devoir constamment sortir de nouveaux titres pour exister.
Oui, je sais que je suis très chanceux. Et je suis heureux de voir que les gens sont toujours intéressés par ce que je fais, alors que ça fait longtemps que je n’ai rien sorti.
Tu n’as pas eu de demandes de la part de XL, ton label ?
Non, au contraire. Certains morceaux de l’album sont assez vieux. Il y en a certains que j’aurais voulu sortir avant. J’en discutais
avec le label, et ils me disaient : « Non, attends que l’album soit prêt. » Je leur en suis reconnaissant.
Plus de 100 000 nouveaux morceaux sortent chaque jour sur les plateformes de streaming. En tant que DJ, tu te sens parfois submergé ? Est-ce difficile de suivre ?
Il y en a beaucoup trop, en effet, mais, par chance, la plupart de mes découvertes musicales viennent d’amis, d’autres DJ. J’ai aussi quelques endroits spécifiques, à Londres, où je vais chercher des disques. Et puis beaucoup de la musique que je joue date des années 1990, 1980, 1970 ou 1960. Je joue des choses suffisamment éclectiques pour ne pas avoir à suivre les tendances musicales. J’essaie quand même de me tenir au courant de ce qui sort, mais quand tu produis de la musique, écouter trop de nouveautés n’est pas forcément une bonne chose. Ça t’influence trop, et je veux que ma musique ait un côté intemporel, qu’elle ne soit pas coincée dans une époque.
Tu produis de la musique tous les jours ? Tu as une routine ? Par exemple, te rendre tous les jours au studio ?
J’ai essayé ça pendant quelque temps, bosser de 9 h à 17 h, comme si j’avais un boulot normal. Même si ça ne fonctionnait pas, je restais assis dans mon studio toute la journée. Bon, ça ne m’a pas rendu très heureux. J’ai essayé d’autres façons de travailler, mais je n’ai jamais trouvé de solution miracle. J’aimerais, pourtant… Pour le moment, je m’y mets quand je sens que c’est bon, peu importe l’heure qu’il est. J’ai intégré le fait d’avoir un boulot bizarre, qui m’autorise à aller travailler à minuit si je veux. Je suis plutôt chanceux, en fait.
Tu as un studio à la maison, j’imagine.
Oui, j’en ai chez moi, à Hackney, et un autre à l’extérieur, à Soho. Mais la plupart des bons trucs que je fais, finalement, c’est sur mon ordinateur, au casque, dans un avion.
Voir cette publication sur Instagram
Où trouves-tu l’inspiration ?
J’essaie de plein de choses, comme aller voir des films, des expos… Mais la plupart du temps, ce qui m’inspire le plus, c’est tout simplement d’écouter de la musique. Souvent à la radio, d’ailleurs. Écouter la radio en conduisant est probablement ma plus grande source d’inspiration. Aller en club aussi. J’y vais moins qu’avant, mais j’y vais au moins une fois par mois.
Tu as des clubs de prédilection ?
Ça dépend des gens avec qui je suis, de qui joue… Il n’y a plus de clubs incontournables à Londres, désormais. Je vais quand même assez souvent au MOT, qui est l’endroit où j’ai lancé une résidence il y a quelques semaines. Il y a de bons line-up et une bonne ambiance.
On en discutait il y a peu avec Joe Goddard (cf. Tsugi 172), qui disait que c’était difficile pour les clubs à Londres en ce moment.
J’ai l’impression que c’est la même histoire partout en Europe. J’ai été dans plusieurs pays ces derniers temps et c’est à chaque fois la même discussion qui revient. Je pense que c’est générationnel. Les jeunes boivent moins et sortent moins. C’est aussi lié à la façon dont les gens consomment la musique. Il y a un côté moins tribal. Tout est partagé rapidement, les scènes ont moins de temps pour grandir, se construire. Les temps ont changé, c’est tout. Mais j’ai 35 ans maintenant, peut-être qu’il y a des gamins
de 19 ans qui ressentent la même chose que moi lorsque j’allais en club à leur âge.
À lire sur Tsugi : Joe Goddard : « Londres est devenue une ville très riche » | INTERVIEW
Tu te souviens de la première fois où tu es allé dans un club ?
Oui. Ce n’était pas un très bon club. C’était en 2005 ou 2006, j’étais avec Romy et Oliver, on était encore à l’école, on était allés au Metro Club, à Tottenham Court Road, un petit club qui passait du rock indé, des trucs comme Joy Division. C’était sympa, mais ce n’était pas ce qu’on pourrait appeler une expérience de clubbing marquante. Ce n’est que plus tard, quand je suis allé au Plastic People et au Mass, des endroits qui jouaient du dubstep, le son du sud de Londres, que j’ai pris une claque. Je me suis tout de suite senti très proche de cette scène. C’était excitant.
Tu mixais déjà à ce moment-là ?
Je mixe depuis que j’ai 10 ans. Principalement dans ma chambre. À partir de 15-16 ans, j’ai commencé à le faire dans des bars à Camden, mais personne n’y prêtait attention. Le processus a été long avant que je devienne vraiment un DJ. Mais je suis DJ depuis plus longtemps que les gens ne le pensent. (sourire)
À 15 ans, tes parents te laissaient aller mixer dans des bars ?
Je ne pense même pas qu’ils savaient. Ils n’étaient pas vraiment là à ce stade de ma vie. Ils me laissaient souvent seul, ce qui
était plutôt bien pour moi en réalité.
J’ai lu que tu avais appris le deejaying avec l’un de tes oncles, qui était DJ sur une radio pirate à Sheffield.
Oui, il m’a offert mes premières platines quand j’avais 9 ans. Et des disques faciles à mixer. Des disques de house qui n’étaient pas forcément très bons, mais… C’est comme ça que j’ai appris. J’avais un autre oncle qui était à New York et qui m’envoyait des mixtapes.
Cet héritage familial a eu de toute évidence une influence sur toi. Je ne sais pas si tu as des enfants, des neveux, des petits-cousins…
(Il coupe) Non.
Tu aimerais transmettre la même chose à quelqu’un de plus jeune, devenir une sorte de mentor ?
Bien sûr, j’adore cette idée. Quand j’étais enfant, la première fois que je suis allé dans un studio, c’était chez le père d’un ami, Colin Newman, qui était dans le groupe Wire. Il avait un studio chez lui et m’a montré ce qu’il faisait. Ça m’a marqué. Je n’avais jamais réfléchi à ce que pouvait être la production musicale auparavant. J’adorerais faire la même chose pour quelqu’un d’une autre génération, transmettre un savoir. Mais je ne connais pas tant d’enfants que ça pour le moment ! J’imagine que ça finira par arriver.
« J’achète tout le temps du nouveau matos, des nouveaux plug-ins. Je trouve que faire des erreurs sur des choses que tu n’as pas l’habitude d’utiliser est une bonne façon d’avancer. »

Revenons à l’album. L’une de ses caractéristiques, c’est qu’il y a beaucoup de samples. Qu’est-ce qui te pousse à utiliser un sample ?
Ça dépend. J’achète et j’écoute beaucoup de disques. Si j’entends quelque chose d’utilisable ou qui m’inspire, je le garde dans un coin de ma tête et quand je fais de la musique, j’y repense en me disant que ça pourrait coller avec le morceau sur lequel je travaille. Mais parfois, j’écoute quelque chose et je trouve ça tellement bien que je me dis qu’il faut juste que je le sample et que je crée un morceau à partir de ça.
J’imagine que parfois, tu choisis un sample, mais tu ne peux pas l’utiliser pour une question de droits.
C’est très frustrant en effet. Il y a un morceau que je n’ai pas pu mettre sur l’album à cause de ça. Et il y a des passages que j’ai dû refaire parce que le label ne voulait pas clearer les samples. J’ai l’impression que ça devient de plus en plus difficile. J’adore sampler, c’est comme ça que j’ai appris à faire de la musique, et je suis très content d’avoir pu le faire pour cet album, mais il va sans doute falloir que j’arrête et que je passe à autre chose, parce que ça devient vraiment pénible.
Quel était le sample que tu n’as pas pu utiliser ?
Un disque de jazz de Woody Shaw. Après, je vais peut-être utiliser ce morceau pour mes DJ-sets.
Et l’intelligence artificielle ? Il existe sans doute des outils qui pourraient t’aider à contourner cette problématique des samples ?
J’ai trouvé un outil qui permet de séparer les pistes d’un morceau. La technologie est au point et ça sonne vraiment bien. C’est assez incroyable, en fait. Mais pour être honnête, je trouve ça… C’est juste trop ! Quand toutes les options sont disponibles, que je peux prendre une caisse claire sur un morceau de Fleetwood Mac sans que personne ne le sache, ça représente trop de possibilités. J’ai besoin de limites pour composer. L’une des raisons pour lesquelles j’adore sampler, c’est qu’il y a des limites. Et puis sampler, c’est aussi une manière de rendre hommage à un morceau, de ramener une vibe.
Ton matériel sonore a évolué avec les années ?
Je continue d’utiliser Logic, parce que c’est très facile pour moi. Je le manie les yeux fermés. Et je n’ai pas vraiment envie d’apprendre à utiliser un nouveau logiciel. Mais j’achète quand même tout le temps du nouveau matos, des nouveaux plug‑ins, parce que je trouve que faire des erreurs sur des choses que tu n’as pas l’habitude d’utiliser est une bonne façon d’avancer.
Ces dernières années, tu as aussi fait un peu de production pour d’autres artistes, comme Skrillex, Frank Ocean ou Tyler, The Creator. C’est un exercice qui te plaît, que tu aimerais développer ?
C’est un challenge et c’est un bon exercice, dans le sens où tu dois travailler rapidement. Mais à chaque fois que j’ai participé à l’une de ces sessions, je me suis rendu au studio avec la boule au ventre, en me demandant comment j’allais m’en sortir. C’était terriblement angoissant. Et puis une fois que j’y suis, tout se passe bien finalement. Enfin, c’est toujours un peu gênant au départ, mais tu finis par créer une connexion avec les autres, à faire de la musique, et avec un peu de chance, à la fin, tu sors quelque chose de bon.
Mais je suis quand même mieux chez moi, à faire de la musique tout seul. C’est là que je me sens le mieux. Mais voilà, parfois, il faut se forcer à faire des choses inconfortables qui peuvent être positives. Donc j’en referai à l’occasion, si le projet me paraît bien et que je sens une bonne connexion avec les gens.
Tu refuses beaucoup de demandes ?
Oui, même si je ne les vois pas toutes passer, pour être honnête. Mon agent et mon label filtrent.
Il y a des artistes pour lesquels tu aimerais produire des titres ?
Plein. Rosalía, pour commencer, dont je suis un gros fan, comme beaucoup de gens. On a échangé quelques textos, ça a failli se faire… Je ne désespère pas. J’aimerais aussi beaucoup travailler avec un jeune artiste inconnu qui démarre et l’aider à grandir.
Et refaire un album entier de remixes, comme celui que tu avais fait pour Gil Scott-Heron en 2011 ?
Pourquoi pas ? Si ça me semble pertinent. Mais je ne sais pas… Je veux dire, je ressens beaucoup plus de pression aujourd’hui. À cette époque, j’étais juste enthousiaste, excité à l’idée de faire de la musique. J’étais content qu’on me demande de faire de la musique, je ne me prenais pas la tête. Mais si Gil Scott‑Heron était encore vivant et que je devais faire ce disque aujourd’hui, je me torturerais trop l’esprit et je serais sans doute incapable de finir le projet.
Quand tu parles de pression, d’où vient-elle : des médias, du public, de l’industrie du disque ?
Elle vient juste du fait que… C’était une légende !
Et quand tu l’as fait, tu ne t’en rendais pas compte ?
Pas vraiment. J’étais juste naïf. Ce qui peut être très utile parfois, je le reconnais.
L’an dernier, nous avions interviewé Romy ici même. Elle disait que vous étiez déjà en train de travailler à un nouvel album des xx. Où en êtes-vous ?
On essaie de se voir une semaine par mois, pour composer. Le simple fait de se retrouver ensemble dans une pièce, c’est déjà très sympa. Ça faisait longtemps. On a tous des projets à côté, ce qui complique parfois les possibilités de se réunir, mais c’est aussi ce qui rendra cet album meilleur. C’est stimulant. Des difficultés naissent souvent de bonnes choses.
Tu ressens de la pression pour ce disque également ?
Pas vraiment, non. Je viens de finir mon album, je suis juste content de pouvoir faire de la musique plus librement. Peut‑être que les autres ressentent un peu plus de pression parce qu’ils veulent faire les choses plus rapidement, mais moi, je veux juste passer du bon temps.
Je pense que Romy est très excitée à l’idée de faire de la « big pop music », alors que de mon côté, mon état d’esprit, c’est plus : tout est permis, ne nous fermons pas de porte, les xx peuvent aller n’importe où et on devrait faire de la musique qui soit facile à faire… Donc on a des approches différentes. Mais c’est bien, on va finir par se retrouver quelque part à mi‑chemin et ce sera le bon endroit.