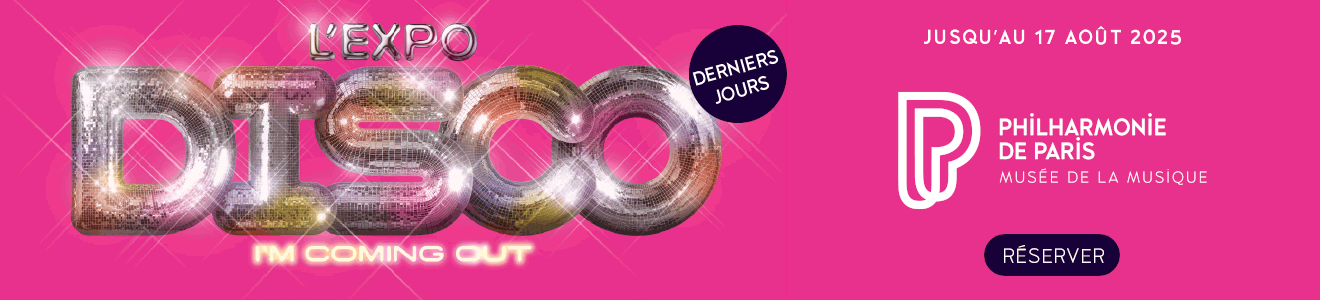Devenue l’une des figures de proue du label Ninja Tune, reconnue pour ses DJ-sets passionnés comme pour ses productions house enjouées, la Canadienne Jayda G revient avec Guy, deuxième album qui rend hommage à son père, et sur lequel cohabitent l’envie de faire danser et celle de faire réfléchir.
Cet article est extrait du Tsugi 161 : Jayda G, Rahill et Nabihah Iqbal, les nouvelles reines de Ninja Tune
Elle reçoit en visio, mais à la maison, en jogging, une tasse de café à la main. Ce n’est pas forcément fréquent, Jayda G faisant partie de cette catégorie de DJs toujours par monts et par vaux, de retour du Brésil avant de s’envoler pour l’Égypte puis Ibiza. Originaire de Grand Forks, une petite ville de 4000 habitants de l’Ouest canadien, elle s’est installée à Londres en 2019, après des escales à Vancouver, Los Angeles et Berlin, et s’y sent désormais comme chez elle. « À Berlin, j’en étais arrivé à un point où je venais tellement à Londres, entre la promotion de mon premier album, ma résidence sur la BBC et celle au club Phonox, que je crois que je n’étais plus que trois ou quatre jours par mois à la maison. Ça n’avait plus vraiment de sens de continuer à vivre là-bas. Toute mon équipe est ici : mon management, mon label, mon équipe de stylisme. C’est plus simple en termes de travail. J’y ai beaucoup d’amis, en plus. Et la langue aide, évidemment. Ça n’a pas été un déménagement difficile. » Envisagerait-elle de rentrer un jour à Grand Forks ? « Je ne sais pas… J’y pense assez souvent, en fait. J’y retourne au minimum deux fois par an, pour voir ma mère, mes amis. Et puis mon mari est également originaire de là-bas. Donc on en parle parfois, on se dit qu’on y reviendra quand on sera plus vieux. Mais Grand Forks est une petite ville très calme, à six heures de Vancouver. Ce n’est pas l’idéal lorsque tu es DJ et que tu tournes partout dans le monde. »
Redécouvrir son père
Ce ne sera sans doute pas dans les mois à venir, donc, le rythme des tournées n’étant pas appelé à diminuer pour la DJ, productrice et chanteuse, dont la carrière grimpe irrésistiblement depuis la sortie de son premier album en 2019 sur Ninja Tune, Significant Changes. Entretemps, il y a eu « Both Of Us », single house redoutable publié en pleine période Covid, qui a fait espérer à des millions de personnes le retour des clubs et l’a propulsée aux Grammy Awards, nominée dans la catégorie meilleur titre dance ; il y a eu des remixes pour Dua Lipa et Taylor Swift, un DJ-Kicks, des prestations à Glastonbury et Coachella… Autant de marqueurs d’une forme de réussite musicale qui ont fait de son deuxième album un disque attendu. Un album charriant house et R&B, plus pop dans la forme, mais plus intime dans le fond, dédié à son père, William Richard Guy. « Le point de départ, c’était vraiment de parler de mon père. Il est mort quand j’avais 10 ans. Il a été malade pendant longtemps, durant cinq ans. Comme il savait qu’il allait mourir, il a décidé de raconter sa vie sur des cassettes vidéo. Il a enregistré onze heures de bandes. J’avais toujours eu en tête cette idée de faire un album autour de ces cassettes vidéo, parce qu’il y a tellement d’histoires que je voulais en faire des chansons, mais ça m’a pris du temps avant de le faire. Quand tu tournes tout le temps, que tu voyages à travers le monde, c’est compliqué. Je sais que certains sont très doués pour composer de la musique sur la route, mais je n’en fais clairement pas partie ! Et puis la pandémie est arrivée. J’ai eu du temps pour m’attaquer à ce projet. »
Son père, décédé d’un cancer il y a un peu plus de vingt ans, a eu à la fois une vie singulière et l’une de celles à laquelle de nombreux Afro-Américains pourront sans doute s’identifier. Né à Kansas City dans les années 1950, dans un quartier pauvre, il fut très vite confronté à la violence, au racisme et aux fins de mois difficiles, et décida, pour s’extraire de cet environnement, de s’engager dans l’armée à l’âge de 18 ans. En pleine guerre du Vietnam, il fut envoyé en Thaïlande, se demandant ce qu’il faisait là. De retour aux États-Unis, il s’installa à Washington, fut DJ dans une radio la nuit, avant de se faire arrêter par erreur par la police durant les émeutes de 1968 faisant suite à l’assassinat de Martin Luther King. Il partit ensuite pour le Canada, où il refit sa vie, reprit l’école afin de devenir travailleur social et où il rencontra la mère de Jayda.
L’écotoxicologie aux platines
De son père, Jayda G conserve des souvenirs tendres, souvent liés à la musique. « Je me souviens qu’il nous faisait des mixtapes pour les longs road trips que l’on faisait à travers le Canada ou vers la Californie. Je me souviens aussi qu’il achetait ses CDs via un catalogue. Je m’asseyais avec lui sur le canapé et on feuilletait le catalogue pour choisir les disques à commander. La musique était importante. » Mais se replonger dans les récits de son père fut aussi une occasion de le redécouvrir. « Tu sais, quand tu es enfant, tu vois tes parents comme des gens qui semblent tout savoir. Et puis tu grandis, et tu te rends compte qu’ils galèrent comme tout le monde, et qu’ils n’ont pas toutes les réponses. Mon père est décédé avant que ça n’arrive. Donc replonger dans ces cassettes a été une façon de réapprendre qui il était, avec une perspective d’adulte. Ça m’a permis de mieux comprendre les histoires qu’il racontait, d’en saisir la profondeur. Et en partageant ses histoires, j’autorise les autres à se les approprier. Ça m’arrive tout le temps quand j’écoute de la musique ou que je lis un livre, je m’identifie à l’histoire d’un autre, je me vois dans l’histoire d’un autre. Ça aide à se connecter avec les autres. Et c’est ce qui est le plus important à la fin. Ces expériences humaines qu’on partage, c’est avant tout une façon de se connecter aux autres. »
Ce besoin de connexion est sans doute ce qui l’a amenée à délaisser la carrière de biologiste qui lui était promise pour épouser celle de DJ. Diplômée d’un master en ressources et gestion environnementale, avec spécialisation en toxicologie environnementale, elle a durant un temps mené de front études en biologie et deejaying, avant de choisir de se consacrer pleinement à la musique au moment de la sortie de son premier album. « Mais toute ma famille est assez surprise que je sois DJ, finalement. Moi aussi, d’ailleurs !« , ajoute-t-elle en riant. Elle se considère néanmoins toujours comme une scientifique. Sa bio sur Instagram le rappelle, d’ailleurs : « DJ, productrice de musique et écotoxicologue. »
« Je ne fais pas de recherche, je ne travaille pas dans un labo, mais j’essaie de faire coïncider mon amour des sciences à celui de la musique, explique-t-elle. Beaucoup de mes premiers morceaux faisaient référence à ma carrière scientifique. Mon premier album était une ode à la thèse que j’écrivais. En 2019, j’ai organisé une série de conférences à Londres, intitulées JMG Talks, où j’invitais les gens à venir écouter de jeunes scientifiques que j’interviewais. Je veux rendre la science plus accessible, et c’est sans doute pour ça qu’une boîte de production m’a contactée pour faire un documentaire environnemental. »

© Nabil Elderkin
Un délicat exercice d’équilibre
Réalisé par Nicolas Brown (Serengeti : les clés de notre avenir), produit par Fernando Meirelles (La Cité de Dieu) et mis en musique par RZA et Seu Jorge, ce film, intitulé Blue Carbon, sortira en fin d’année. Jayda en est la narratrice. Une grande fierté pour elle, le sujet abordé lui tenant à cœur. « Le film parle des écosystèmes océaniques côtiers, appelés écosystèmes de carbone bleu : les marais salés, les mangroves, les herbiers marins, qui sont très efficaces pour contenir le dioxyde de carbone en dehors de l’atmosphère et le stocker dans le sol. Des sortes de puits de carbone naturels qui permettent d’atténuer le changement climatique. Tout le sujet du film est là : si nous défendons ces écosystèmes, si nous les protégeons et les aidons à croître, nous pouvons lutter contre le réchauffement climatique. Et c’est aussi un sujet de justice sociale, car le film parle du décalage entre ceux qui vont subir le changement climatique et ceux qui contribuent à ce changement. Entre les pays en développement et le monde occidental. » Des préoccupations écologiques qui ne s’accommodent pas forcément très bien avec sa carrière de DJ, elle en a bien conscience. « Je voyage pour vivre. Je suis la première à reconnaître que mon mode de vie n’est pas durable, j’ai une empreinte carbone énorme. Pour essayer de contrebalancer, je participe à un programme de compensation carbone. Je calcule le volume de CO2 que je génère et je reverse ensuite une partie de mes revenus de tournée à des organisations qui luttent contre le réchauffement climatique. D’ailleurs, le film évoque cela également : lorsque l’argent est directement mis entre les mains des gens qui vivent à côté de ces écosystèmes océaniques et qui en prennent soin, cela peut être bénéfique. Car on sait très bien ce qu’il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut juste donner les moyens aux gens de le faire.« Si elle ne fait pas partie de cette catégorie de musiciens doués pour composer de la musique sur la route, elle le reconnaît, en revanche, elle fait partie de cette catégorie de gens optimistes de nature, qui veulent croire à un monde meilleur. « L’espoir fait partie de notre nature humaine. C’est ce qui nous aide à continuer, à essayer de trouver des solutions. Dans la musique, beaucoup de gens essaient de trouver des solutions. Beaucoup de festivals essaient d’être plus durables. Et c’est le plus important, que les gens essaient. » C’est l’une des leçons qu’elle a retenues de son père, qui a tout fait pour avoir une vie meilleure.