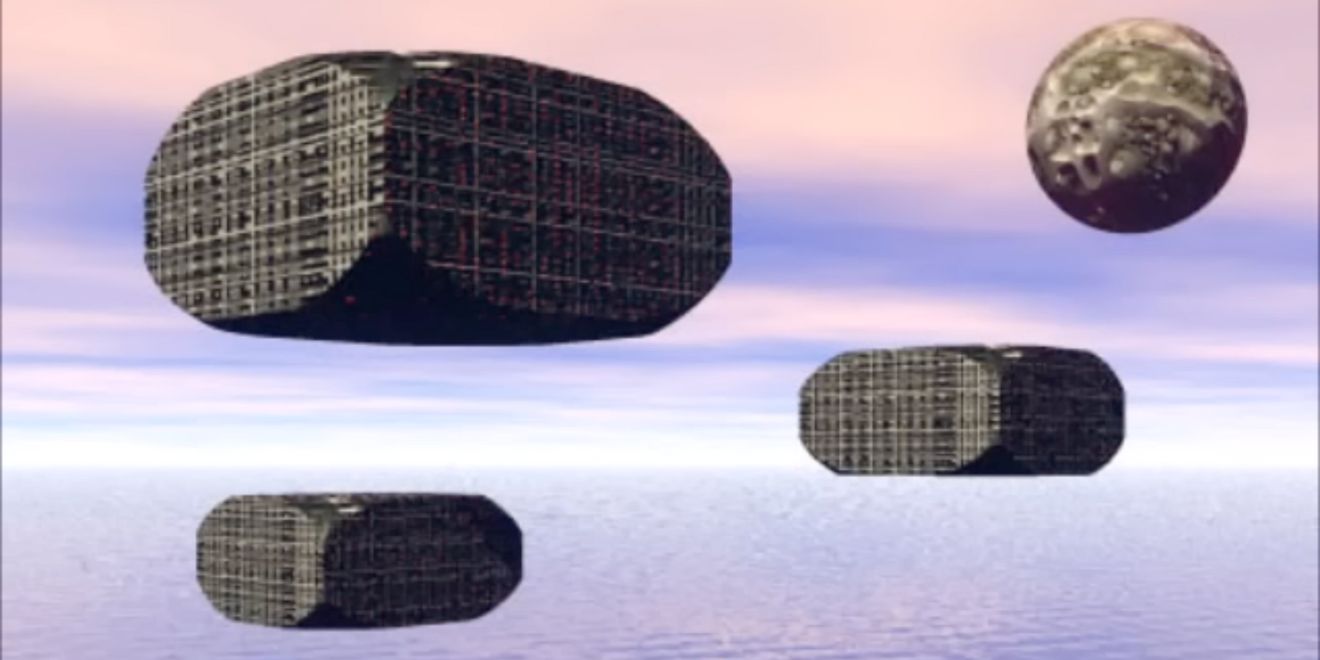La rentrée fut joyeuse à Cologne, où le c/o pop est toujours assez varié pour que tout le monde s’y retrouve, même après 15 ans d’existence.
Dans l’IHK, chambre du commerce et de l’industrie de Cologne, la branche « Convention » du c/o pop s’étale sur des dizaines de conférences, dont un petit nombre se tient en anglais. Dans une salle de réunion du haut, deux Italiens tentent de convaincre une grappe de directeurs de festivals d’alimenter leurs événements à l’hydrogène. Ailleurs, on discute des rapports attachés de presse/journalistes. Mais c’est le panel sur les « politics of dancing » qui attire le plus de monde. Quatre hommes de plus de 45 ans et une femme, tous blancs, devisent laborieusement sur les origines marginales et la diversité sociale et ethnique aux origines de la club culture, ainsi que sur les effets pervers de son industrialisation. Parmi les petits pics et maladresses qui ponctuent la discussion, un échange se distingue : le modérateur, peu avisé, demande au directeur du festival athénien Reworks s’il a noté des « gestes de solidarité » de la part d’artistes à l’affiche d’une édition plombée par la crise bancaire. Sans hésiter, le Grec lui répond fièrement : « Pour être franc, nous n’avons pas joué la carte de la charité envers la Grèce », avant d’ajouter plus loin « Ce qui arrive chez nous pourrait parfaitement arriver chez vous ».
Heureusement, le vrai c/o pop, celui qui résonne dans une quinzaine de lieux de la ville de Cologne, ne ressemble pas à une série de malaises digne de The Square de Robin Ostlund. Comme dans bien d’autres festivals (on pense aux Trans Musicales à Rennes, au Spot au Danemark), cette quinzième édition s’étend d’un côté sur une partie showcase, orientée pro et plutôt sage, et une partie nocturne, plus palpitante, qui agite une foule majoritairement locale (presque aucun Français, un Paris-Köln équivaut pourtant à un Paris-Marseille). Une fois passés le garage rock convenu d’Iguana Death Cult (présenté par le bureau export hollandais) et le stand-up indie-pop teuton de Blond, c’est un groupe berlinois, Jaguwar, qui nous fait passer aux choses sérieuses le vendredi soir dans le Studio 672, sous-sol du Stadtgarten. Le power-trio, a priori inoffensif sur disque, se gonfle d’une force poignante sur scène, et transforme chacun de ses morceaux de shoegaze-pop aux milles influences en d’épiques confrontations. Juste après, sur la petite scène du Stadtgarten Restaurant, c’est le duo local beatmaker/bassiste No Visa, tout juste une K7 à la ceinture, qui bricole une électro-pop instrumentale et miniature, étouffée comme si on l’entendait sur une vieille bande, un geste audacieux en live, qui sécrète le même funk fantôme qu’un Sand Circles, et le même charme intime qu’un Black Marbles.

De retour dans le Studio 672, gros coup de pression de Coucou Chloé. La Londonienne ex-Niçoise performe dans le noir, laissant les basses de ses prods ultra-sexy et intelligentes dominer la salle. Derrière son vocodeur monocorde et malsain en diable, on la fantasme en M.I.A. de l’internet wave, fomentant le r’n’b sombre et masochiste qui dominera, on l’espère, les charts mondiaux d’ici moins de trois ans. C’est juste la décharge nécessaire pour s’enfoncer dans le set traditionnellement borderline du Londonien Actress, qui fait pencher le dancefloor avec ses beats contrariés, et décompose joyeusement le « West End Girls » des Pet Shop Boys. La nuit se bouclera dans le club adjacent, le Gewölbe, où Lena Willikens et Vladimir Ivkovic achèvent dans l’extase un set de huit heures d’électro, toujours à faible BPM pour mieux en laisser le psychédélisme infuser.
Samedi, on rallume le sapin en douceur avec un trio de performances ambient/expé dans la Christuskirche, église évangélique ultra-moderne transformée en salle de spectacle, qu’un simple halo bleu transforme en une installation digne de James Turrell. Les Belges Ssaliva l’investissent en créant une jungle sonore de synthèse, qu’ils déséquilibrent ponctuellement par une rupture inattendue, une boucle de travers, un choix de son un peu limite, ou une grande embardée dramatique. Le local Tearss opte pour une palette plus aquatique et des compos plus classiques, passant en revue tous les courants de l’ambient contemporaine, visiblement marqué par la désormais culte compilation Mono No Aware du label Pan. En clôture, la Canadienne Kara-Lis Coverdale prend un léger contrepied en diversifiant ses sources sonores, laissant s’échapper un manège d’arpèges sur orgue qui résonne étrangement avec le lieu. Avant d’aller clubber, un tour s’impose à la Funkhaus Wallrafplatz, qui accueillit dans les années 50 les premières des créations les plus radicales de Stockhausen ou Zimmermann. Ce soir, c’est la Norvégienne Jenny Hval qui s’y produit, et s’avère moins radicale qu’elle ne semble le croire : une pop électronique bonne à sonoriser des bars à quinoa scandinaves, à l’écriture certes mouvante, mais qui fleure bon la fausse sophistication. Pourtant, le compte y est, et la section cuivre étonne, mais d’embarrassantes tentatives de « performance art » en plein concert gâtent le tout comme autant de private jokes mal placées.

Crédit photo : Christian Faustus
De l’embarras, il y en aura aussi pas mal pour la nuit Kompakt qui fête ici ses 25 ans sans grand panache – mais au moins, eux, sans prétention. L’ancien bastion de prestige et fleuron local n’a pas réuni ses figures les plus historiques pour l’occasion (quid d’Aguayo, Koze, Superpitcher, ou de Gas, qui traîne pourtant dans le public ?), et nous propose en quelque sorte un service de seconds couteaux. Certains donnent bien le change, comme Ada qui assure une house de cocktail jamais grossière avec un groove ramassé, ou Geibr. Teichmann, aux manettes d’un set de crudités tropicales incroyablement rafraîchissantes dans ce contexte. En revanche, on grince des dents sur la schaffel-house-pop de The Modernist ou le live techno bas du front de Reinhardt Voigt, lui-même pas avare en mimiques lourdingues sur scène. On finit néanmoins dans la liesse collective à la Stadtgarten Saal, où le patron Michael Mayer redresse son set avec quelques classiques du catalogue (un remix du « Timecode » de Köhncke, l’éternel « Maria » de Closer Musik) ou des standards pop (« It’s My Life » de Talk Talk), tous empreints de cette tendresse et de cette générosité qui ont façonné ce label, et, d’une certaine façon, ce festival.
Meilleur moment : Köln, antithèse de Berlin avec sa bonne humeur provinciale, son esprit de village, son public candide, et son imprenable cathédrale. Là-bas, même le trash revêt une certaine innocence.
Pire moment : on pourrait penser aux changements intempestifs et guère relayés de line-up (qui nous ont fait louper T.Raumschmiere, entre autres), mais c’est peut-être le faux départ du débat sur les « politics of dancing » qui décroche la timbale, lorsque le modérateur n’arrive pas à lancer une vidéo sur les manifestations géorgiennes pour la réouverture du club Bassiani, dans une salle nommée le « Digital Lab ». Une allemande se gausse à haute voix au fond de la salle : « Digital ? Ha ! ». Encore merci à elle.