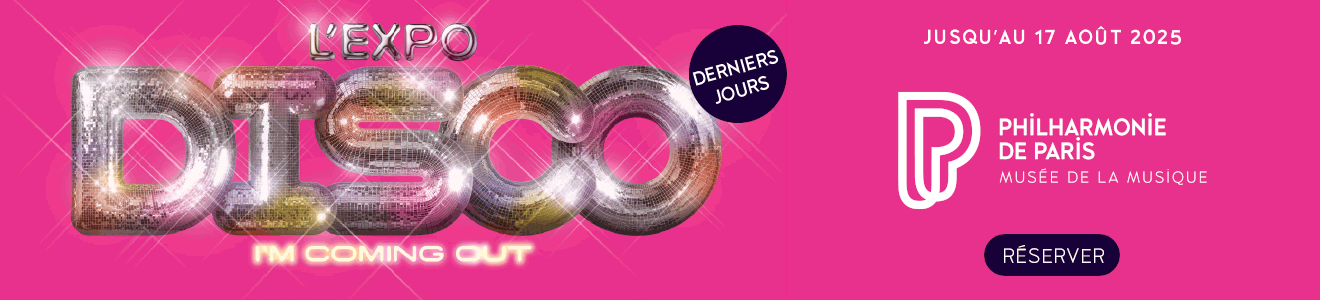Avec la réussite de Nini, deuxième album aussi exubérant que sensible, Bonnie Banane aime plus que tout transfigurer les petites histoires, d’amour ou du quotidien. Perchée ? Un peu, mais pas que. La preuve dans cette interview au long cours.
Article rédigé pour le Tsugi 169
Bonnie Banane, une histoire de voix.
De voix fortes, de voix qui portent et emportent. De voix exprimant aussi une différence quand tant d’autres se contentent de refrains connus. Jouant freestyle avec ses cordes vocales, Bonnie Banane est apparue sur la scène hexagonale au milieu des années 2010. Une tornade. Zigzaguant en toute liberté entre français et anglais, pop électro et R&B, celle qui se nomme Anaïs Thomas à la ville s’avère largement indéfinissable et insaisissable, comme sur l’EP fantasmagorique Sœur Nature (2015). Plus tard, la lumière hit jaillit avec son featuring sur « Le Code » de Myth Syzer. Un premier album, Sexy Planet (2021), transperce la pandémie.
On l’adore ensuite sur la scène de l’Hyper Week-End Festival 2023 en compagnie de son complice Flavien Berger, pour une adaptation ludique du répertoire de Brigitte Fontaine et Areski Belkacem. Similitudes évidentes, malgré les différences d’époques, entre ces géniaux trublions. Et aujourd’hui arrive ce nouvel album, Nini, resplendissant jeu de piste aux lignes musicales plus ou moins brisées où l’amour est au centre du « je », tout comme une certaine observation sociale avisée qui résonne dans ses textes ludiques et à
tiroirs, dont l’écriture semble aussi libre que mûrement réfléchie.
Trop souvent réduite à un personnage qui ne serait « que » rigolo, Bonnie Banane expose pourtant ici une palette riche en sentiments les plus divers, exprimant autant la colère ou les pleurs qu’une certaine euphorie. D’où notre première question.
Le dernier titre de Nini s’intitule « Joie intense, tristesse profonde ». Est-ce ce que l’on doit ressentir à l’écoute de ton album ?
En réalité, le titre complet était même « Joie intense, tristesse profonde, angoisse mondiale ». Au dernier moment, je me suis dit non, ce n’est pas possible. Si je l’appelle comme ça, comme c’est très long à dire, tout le monde va le réduire à « Joie intense ». Ce qui ne correspond pas du tout au large spectre des émotions traversé par les chansons. Si tu écoutes « The Nap Song », « Hoes Of Na » ou même « Sacha », ce sont quand même des humeurs assez drastiquement opposées. Ce n’est pas pour rien que cela a été un titre de travail.

©DR
Le premier single « Franchement » possède un côté un peu punk, virulent. Est-ce que c’est une manière de dire d’emblée que Bonnie Banane, ce n’est pas de la blague ?
C’est vrai sur cet album je me suis davantage autorisée la virulence, la colère. C’est ce qui a changé par rapport à l’album précédent Sexy Planet. J’ai d’ailleurs hâte de jouer ce titre en live. Il y a un petit côté envie de tout démolir, quelque chose d’apocalyptique. Mais en même temps sur « Instant Karma » ou « The Nap Song », je n’étais jamais allée aussi loin dans une sorte d’extrême douceur.
Quand on lit tes textes, on se rend compte qu’ils sont toujours traversés par des tensions…
Dès que j’éprouve une certitude, j’essaie toujours de me contredire direct après. C’est un mouvement permanent. Et puis je suis autant fascinée par l’amour qui triomphe que par l’amour impossible. J’aime bien les opposés, les contrastes, les extrêmes. Bon pas l’extrême droite, bien sûr. (rires)
On a également l’impression que, comme le chantaient Les Rita Mitsouko, tes histoires d’amour finissent mal en général…
Ah, j’adore cette chanson ! Je me retrouve davantage dans cet amour impossible qui me transcende dans des livres ou des films. Ça me transporte et ça m’inspire en tout cas. Mais tout comme l’amour heureux, l’amour éternel. C’est beau quand même.
Généralement, comment fonctionne l’inspiration chez toi ?
Dans une tension entre une solitude assez profonde et nécessaire et le contact avec les gens, l’échange. Comme un aller-retour entre les deux. L’album ressemble à ce que j’ai vécu pendant les deux ans que j’ai mis à le faire. La rencontre avec Janoya a été un déclencheur, on a vraiment composé le disque à trois, avec Monomite également, que je connais depuis longtemps. L’excitation de faire de la musique ensemble a été le moteur. On a ensuite fait venir du monde comme Félix Petit, qui a réalisé l’album avec moi. Puis on est allés enregistrer et mixer avec Antoine, Pierre et Louise, au studio Motorbass.
Avec Sexy Planet, tu voulais faire groover la France. Est-ce que Nini poursuit le même objectif ?
J’aimerais qu’il y ait au moins une évacuation du public en civière à chaque concert. Je veux que les gens tombent dans les pommes. Je plaisante bien sûr. Mais plus sérieusement, il y a une envie de quelque chose de plus frénétique, d’un peu plus suant.

©DR
On a l’impression aussi que tu cherches souvent à provoquer l’auditeur, qu’il se demande ce que tu as bien pu vouloir dire…
Je crois que c’est assez récurrent chez moi. Mon ami Monomite m’a d’ailleurs dit un jour : « Ta musique, elle met les gens dans leurs pensées. » Je me souviens que quand j’étais petite, j’écoutais la bouche un peu ouverte, comme si j’assimilais tout en réfléchissant. Donc peut-être que j’aimerais que l’on m’écoute de cette façon. Mais d’une manière générale, comme on s’est autorisé beaucoup plus de choses que sur Sexy Planet,
j’ai envie que ce soit la même chose pour le public.
Dans la chanson « Instant Karma », tu donnes l’adresse du studio Motorbass où tu as enregistré. Faut-il y voir un hommage à son créateur, hélas disparu, Philippe Zdar ?
C’est un peu un hasard. On ne savait même pas qu’on allait bosser à Motorbass quand on a fait cette chanson. J’ai rajouté l’adresse a posteriori. Mais quand tu es dans ce studio, tu sens quand même que Philippe est dans la pièce. Des choses se passent, des lumières s’allument soudainement. C’est un peu mystique. On s’est ratés avec Zdar. Il avait écouté Sexy Planet avant de nous quitter, car mon ancienne équipe de management était en discussion pour qu’il mixe l’album.
À lire aussi sur tsugi.fr : Motorbass : la folle aventure du studio de Zdar (mais pas que)
Qui est ce Sacha qui donne son nom à deux titres de l’album ?
Ça peut être un homme ou une femme. C’est l’archétype d’une histoire d’amour. Quand j’écris sur ce sujet, que je m’inspire de ce que j’ai vécu, c’est rarement une seule histoire ou une seule personne que j’ai en tête. Je mélange tout ça, l’amour, mais aussi le deuil. Je n’ai jamais voulu cibler quelqu’un en particulier, parce que ce n’est pas aussi simple que ça. Mais j’avais envie d’une chanson nommée par un prénom, donc « Sacha » maintenant, c’est ma « Ziggy », « Marcia » ou « Valérie ». Même si l’amour n’a pas résisté, la chanson le rendra éternel.
On dirait qu’en amour tu es plus souvent malheureuse qu’heureuse ?
J’ai l’impression que mon envie de donner de l’amour est immense, mais humainement, il y a trop de limites. Ça ne matche pas. Même si la musique m’a beaucoup aidée. Je me retrouve plus dans une forte amitié, qui est une forme d’amour. Je trouve l’amour « couple » un petit peu étroit pour moi. Je préfère l’amour dans son absolu, sous différentes formes. C’est vraiment mon thème favori. Je suis passionnée par l’amour lui-même. J’aime bien juste écrire dessus, en fait. Je ne suis pas obligée de le vivre. J’adore quand les gens sont amoureux, la manière dont ils en parlent. Je suis en mode ébahi quand je les entends.
As-tu appris des choses sur toi-même pendant la réalisation de ce disque ?
J’ai essayé de m’améliorer dans le processus de travail. Je me suis rendu compte de mes limites aussi. J’ai appris pendant cet album à progresser dans ma confiance en moi et en les autres. Je pense que je peux mieux faire encore. J’ai compris aussi beaucoup de choses directement liées à ma vie. Par exemple, il y a des phrases qui agissent comme des révélations et qui s’imposent à moi. Elles me réveillent la nuit et me guident. Un peu comme un souffleur au théâtre qui me dirait : « Fais attention à toi ! Regarde ça ! » C’est assez mystérieux.
Quand j’ai commencé l’album, je me suis réveillée un matin avec une certitude venant de nulle part que mourir, c’était refaire sa vie. La chanson « Instant Karma » découle de ça. C’est pour ça que je chante : « Tu as refait ta vie là‑bas/Je t’aime bien quand même/Même si tu as refait ta vie là‑bas ». Dans le deuxième
couplet de « Red Flags », je dis : « Je me réveille la nuit/j’entends des voix/Il ne pourra jamais rien faire pour toi. » C’est vraiment une phrase que j’ai entendue en rêve et qui est restée.

©DR
Finalement, la création, c’est toujours un peu miraculeux…
Oui et je crois aux miracles. Il faut juste ne pas chercher ni à les attendre ni à les provoquer. Ils s’imposent à toi, mais ils ne se manifestent pas en permanence. D’ailleurs, c’est assez terrifiant la part de prémonition qui existe dans l’écriture. C’est-à-dire que tu t’amuses à écrire quelque chose parce que ça sonne bien, tu te mets dans une espèce de rôle. Et puis ce que tu as décrit, peu de temps après, devient la réalité. Il faut faire attention à ce qu’on écrit, à nos prières. Ça peut vraiment s’exaucer.
C’est vrai que Bonnie Banane est née au Conservatoire national supérieur d’art dramatique en 2013 ?
Un peu avant. Avec des amis, on se marrait en se cherchant des avatars juste pour la manière dont ils sonnaient. Et donc, un des alias que j’avais trouvé, c’était Bonnie Banane. Ça nous faisait rire. C’est devenu mon pseudo Facebook. Avant le conservatoire, j’ai commencé à faire de la musique toute seule dans mon coin, de manière un peu secrète.
Mais j’ai quand même fait écouter à un ami, qui m’a proposé de travailler avec lui. La première année du conservatoire, je bouffais tellement de théâtre que ça m’étouffait, donc pendant le peu de temps libre que j’avais, j’allais faire du son avec mon pote. C’était une respiration. Au bout d’un an, il m’a dit : « On a assez de chansons pour sortir un EP.« C’est vraiment lui qui m’a donné le feu vert, m’a fait prendre confiance. Du coup, je me suis demandé comment m’appeler. Anaïs, ce n’était pas possible, il y avait déjà une chanteuse du même nom. Bonnie Banane est arrivée comme une évidence.
Pourquoi cette volonté d’être comédienne ?
À un moment donné, j’ai voulu me faire violence. Je suis quelqu’un d’assez timide en réalité. C’est terrible d’être sur scène. C’est comme faire du saut à l’élastique. J’ai démarré un peu avant le conservatoire et j’ai ressenti une espèce d’effet physique/métaphysique, comme un vertige. J’ai pensé : « C’est tellement dur, ça paraît tellement impossible que j’ai envie de le faire, j’ai envie de me challenger. » Qui monte sur scène ? Des fous, je crois. Des gens qui manquent beaucoup de confiance en eux et qui se lancent une sorte de défi.
Cette vocation artistique vient de ton enfance ?
Il n’y a pas d’artiste dans ma famille. Même si mon père voulait que je fasse du théâtre, mais j’étais trop timide. C’est Paris (elle a grandi dans le sud de la France, ndr) et des amis qui m’ont initiée à cette culture. Mais, au conservatoire, ma connaissance du théâtre était très pauvre par rapport à d’autres élèves, et je pense qu’elle l’est encore.
Pourtant, le théâtre me passionne. Tout ce dispositif, ce qui se passe sur la scène et dans la salle. L’architecture des lieux, les coulisses, j’adore. C’est quand même une pratique ancestrale et au cours de sa vie, on participe tous à des spectacles. J’adore les enterrements pour ça. En fait, c’est une sorte de spectacle : des gens prennent le micro, mais ils parlent trop près alors ça sature ou alors ils sont trop loin, on n’entend rien, ils ne s’en rendent pas compte. Personne n’ose leur dire « vas-y, éloigne-toi du micro » alors qu’ils enterrent leur père ou leur mère.
Aujourd’hui, comédienne, c’est quelque chose que tu as laissé tomber ?
Non, je ne crois pas. Tous les jours, je pense au théâtre, au cinéma. Fondamentalement, ça m’attire. Même si Bonnie Banane me laisse un grand espace de liberté, ça me manque d’être le soldat de quelqu’un, de respecter sa vision. Mais en France, je n’ai pas l’impression qu’on pense à moi dans les castings ou que j’inspire des gens pour leurs scénarios. En plus, je n’ai ni 20 ans ni 50 ans, je suis dans une tranche d’âge assez compliquée pour les actrices. Peut-être qu’il faudrait que je m’écrive un rôle. J’aimerais beaucoup être réalisatrice. J’adorerais filmer les gens, mais je ne m’en sens pas encore complètement capable. C’est une sacrée montagne à gravir quand même.
Penses-tu que les femmes sont plus respectées dans la musique qu’au cinéma ?
Je ne sais pas. Pendant longtemps, je n’ai pas voulu voir quelque chose qui s’est vraiment imposé à moi dernièrement comme un fait irréfutable : si dans mon métier, je commence à m’emporter, à être pointilleuse, à parler mal, je vais être automatiquement qualifiée de salope, de diva. Alors que si un homme agit de la même manière, il est considéré comme quelqu’un d’exigeant, de charismatique, qui sait ce qu’il veut. Les hommes, même s’ils ne l’admettent jamais, veulent avoir un contrôle sur les femmes avec qui ils travaillent, même si ce sont leurs amies.
J’ai aussi entendu dans un gros label des mecs parler en termes extrêmement misogynes d’une artiste qu’ils venaient de signer dès qu’elle a quitté la pièce. Après, je pense que j’ai eu pas mal de chance dans mon parcours. Et il y a des pièges dans lesquels je ne suis pas tombée. Dès que je trouvais que ça sentait un petit peu le roussi, je partais. C’est ce que je fais dans la vie en général.

©DR
Quand la musique t’est-elle vraiment devenue indispensable ?
Très tôt, vers 3 ou 4 ans. En mode Michael Jackson, Janet Jackson, Prince, Earth, Wind & Fire. Mon père écoutait ça tout le temps, plus beaucoup de funk, G-funk, P-funk. C’était notre décor. Quand je pense à Stevie Wonder, c’est comme s’il faisait partie de la famille. J’ai compris très jeune que la musique t’aidait à vivre, qu’elle était liée à la danse, donc quelque chose d’assez physique où tu te dépenses.
On te compare souvent à Brigitte Fontaine. Comment définirais-tu cette proximité ?
Je crois que c’est moi en premier qui en ai parlé. J’ai dit que je l’aimais beaucoup, que c’était une grande inspiration. Mais je ne lui ressemble pas tant que ça, même pas du tout. Elle est incomparable. Son haut niveau d’écriture est incroyable, un des meilleurs dans notre pays. Elle résonne en moi. J’aime ses prises de parole aussi, mais je ne suis pas farfelue à ce point-là. En tout cas, c’est un honneur pour moi d’être comparée à elle, mais je ne pense pas que ce soit un honneur pour elle. (rires)
As-tu des héros et des héroïnes en dehors de la musique ?
Récemment, Rima Hassan Mobarak, l’une des porte-parole du combat palestinien en France. Sinon, Angela Davis a toujours été quelqu’un que j’admire. L’acteur Paul Reubens pour son personnage que j’adore de Pee-wee Herman. L’astrophysicien- philosophe Aurélien Barrau aussi. Il y en a beaucoup…
Anaïs et Bonnie, ce sont la même personne ?
Oui. Je n’ai pas l’impression de me mettre dans la peau d’un personnage. D’ailleurs, on peut m’appeler avec les deux prénoms. Je m’en fiche.