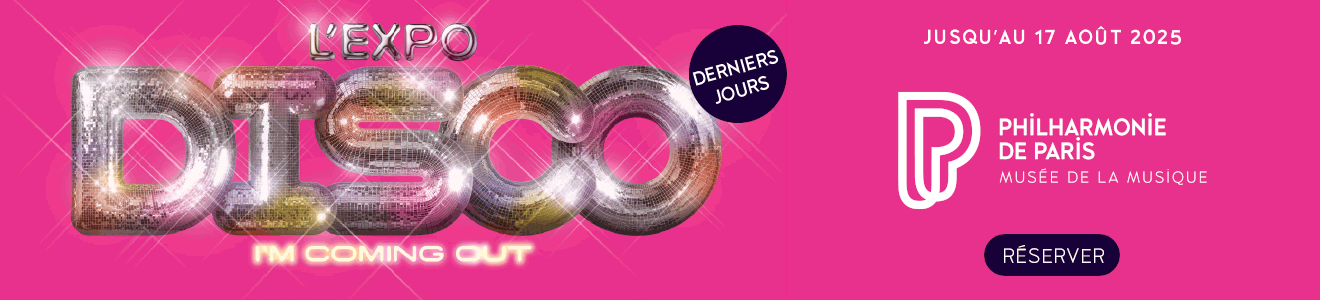Une vieille légende raconte qu’on ne serait pas artiste tant qu’on ne sort pas de sa zone de confort. Et ça, Crystal Murray l’a pris au pied de la lettre. En 2020, la Franco-Américaine faisait parler d’elle avec son single pop et soul « Princess ». Deux ans plus tard, elle vire du tout au tout, avec un deuxième EP Twisted Bases aux notes plus électroniques, aux frontières du punk. En 2024, elle sort son premier album Sad Lovers and Giants, plus de doute : la Princess de 2020 a bien grandi et Crystal Murray n’a jamais été autant à sa place.
« This is for my emotional baddies » lançait Crystal sur la scène du dernier We Love Green. On ne saurait comment mieux résumer cet album, écrit post-rupture. Si sur ce projet, Crystal Murray ne s’est pas limitée dans la recherche des genres musicaux, elle en fait de même dans l’exploration de ses sentiments. Ici pas de mensonge : on accueille la rage, la tristesse, et l’amour dans toute sa pluralité : celui déchu, celui pour la musique, mais surtout l’amour pour soi.
Entre refrains punk, rythmiques drum’n’bass et cette voix éclatante, Crystal Murray se révèle, tant musicalement que personnellement. Cet album, c’est SON projet. Tellement qu’il n’y a aucun featuring, car « l’album est trop personnel pour ramener qui que ce soit ». Ayant envie d’en savoir plus, on a appelé la protagoniste et – même s’il était tôt le matin – Crystal nous a délivré un entretien fort, évoquant son héritage culturel, et comment on raconte une relation toxique en musique.
Deux jours après la sortie de Sad Lovers and Giants, tu présentais l’album sur la scène de We Love Green. Comment ça s’est passé ?
C’était spécial. Je jouais tôt donc j’avais peur qu’il n’y ait pas grand monde. Pourtant, je n’avais même pas fini mes balances qu’il y avait déjà des gens qui attendaient. Je pensais qu’ils venaient pour Troye Sivan… Mais non, ils m’attendaient moi (rires) ! Ça m’a mis tout de suite super à l’aise. J’ai pu montrer d’une manière très sincère ma musique, et raconter les émotions que j’ai mises dans cet album.

©Alessia Gunawan
Pendant ce set, tu as dit que ce disque parle de « la dualité de nos émotions, d’être capable de pleurer dans le club et d’être émotif dans des endroits où tu ne peux pas être émotif ». Comment tu retranscris cette dualité dans ton album ?
Ça part des paroles, mais je ne m’en rends compte qu’en écrivant. Par exemple, j’écris une chanson d’amour puis je réalise que dans l’amour j’éprouve de la rage, de la tristesse et que ce n’est pas si contradictoire. Toutes les chansons embrassent plusieurs thèmes.
Comme je l’ai dit sur scène, « this is for my emotional baddies ». On peut être dans un club, puis quelque chose nous fait penser à notre ex… Mais ce n’est pas pour ça qu’on rentre chez nous.
Musicalement, dans cet album, tu te testes à des styles éloignés : punk, hyperpop, quelques rythmiques électroniques… Est-ce une façon de faire ressortir la « vraie » Crystal Murray ?
Oui complètement ! Pour mes deux premiers EP j’étais assez jeune et je cherchais où je voulais aller. Cet album retranscrit toute ma recherche musicale vers le son hybride exact que je voulais avoir. Oui, ça part dans tous les sens, mais c’est réfléchi !
Au premier EP on me disait que j’étais une chanteuse pop et soul, puis au deuxième « qu’on ne peut pas te mettre dans une case« . J’ai voulu jouer de ça et du fameux ‘son hybride’ de ma génération, qui est elle-même hybride. Personne ne peut vraiment être mis dans une case. On n’en a pas envie.
Tu as commencé ta carrière artistique dans un collectif de mode à la fin des années 2010, Gucci Gang. Aujourd’hui, la mode est toujours importante pour toi ?
J’ai toujours eu cet amour pour l’habit, le visuel… La musique est en moi, et l’image est ce que je retranscris de ces émotions. J’adore la silhouette, j’adore pouvoir m’amuser avec les habits, et le ressenti que ça me donne. Sur scène je suis hyper sexy-serrée, mais c’est comme ça que je suis le plus à l’aise : il n’y a rien qui bouge.
Même sur les clips, j’ai essayé de mélanger cette dualité et hybridité musicale, et de pouvoir faire un truc qui est vrai. Ça peut être très théâtral, ou basé sur des films des années 70 (comme Lady Snowblood de Toshiya Fujita, ou House de Nobuhiko Obayashi, ndlr), je fais jouer mes références, retranscris la dystopie de notre génération et du monde qui m’entoure.
« Je viens d’une lignée de combattants qui ne sont pas là pour parler, mais pour survivre. La musique est ma façon de me connecter, de ressentir. » Crystal Murray

©Erea Ferreiro
Alors, comment es-tu venue à la musique ?
La musique a toujours été là. C’est important de remettre en place là d’où je viens : je suis française, d’un père noir-américain (David Murray, saxophoniste américain de jazz, ndlr) et d’une mère canarienne. Les noirs-américains ont trouvé leur place aux États-Unis notamment grâce à la culture et l’art. Les Espagnoles ont toujours essayé de prendre les Canaries… Je viens d’un endroit où les gens ne sont pas censés être là. Du côté de mon père la musique vient du gospel, de l’Église Américaine, de là où une réparation devait être faite. La musique les a rassemblés, protégés et leur a permis de se créer une identité.
Jusqu’à mes six/huit ans je n’arrivais pas à m’exprimer proprement. Parce que j’apprenais le Français et l’Anglais en même temps et je n’arrivais pas à dissocier les deux. Avec la musique, je m’exprimais de la façon dont je voulais. J’ai toujours chanté, toujours dansé. Je viens d’une lignée de combattants qui ne sont pas là pour parler, mais pour survivre. La musique est ma façon de me connecter, de ressentir.
On a découvert cet album avec tes singles super puissants « PAYBACK », ou encore « STARMANIAK ». C’est important pour toi d’inclure la politique dans tes chansons ?
C’est toujours difficile de répondre à cette question. Parce que je parle de ma vie, des gens autour de moi, de ma communauté. Les paroles de « STARMANIAK » et « PAYBACK » me sont venues très naturellement. Je n’aime pas trop revendiquer cette identité de chanteuse politique ou chanteuse féministe. Oui, c’est politique parce que je suis une femme noire, donc forcément j’entre dans cette catégorie d’identité qui dérange et qui m’empêche d’être de la façon dont je veux être.
Je ne suis pas la meilleure des porte-parole. Je suis plus du genre à donner la parole aux gens qui ont étudié le féminisme noir, comme Rokhaya Diallo ou Bell Hooks.
En parlant de Bell Hooks, pour les inspirations de Tsugi 171, tu disais avoir été inspirée par All About Love. Qu’est-ce qu’il t’a apporté dans la conception de l’album, ce livre ?
Ce que j’ai aimé, c’est qu’on parle de soi-même en parlant d’amour. Il te raconte comment une relation femme/homme peut te réveiller sur ce qu’il se passe dans le monde et surtout dans quel monde masculin on vit. Tu te rends compte de la pression sociale de la femme seule, et comment elle a toujours été mise dans cette position d’hystérique, psychopathe…
Ça m’a ouvert les yeux : sur comment une rage peut devenir de l’émotion, l’émotion peut devenir de l’amour, et l’amour de la rage.
À lire aussi sur tsugi.fr : Tubes : de plus en plus courts ?
Dans cet album, tu évoques la toxicité des relations. Qu’est-ce qui t’a amené à ces réflexions ?
J’ai vécu un amour toxique et j’ai voulu mettre en musique la « réalisation » : je pensais que c’était bien, mais au contraire c’était destructeur. Le moment où j’en suis sorti, je me suis rendue compte que je ne pourrais jamais revenir à une relation toxique. Je n’arrivais pas à me retrouver, et c’est quelque chose qu’il faut arrêter d’idéaliser.
Cet album, c’est aussi une lettre de correction à l’enfant que j’étais, qui s’est fait happer par les années Skins et Tumblr : on se défonce, on crie dans la rue, on est dans des relations toxiques… On se ferme nous-même à un amour sain, parce qu’on pense que c’est ça qui nous fait vivre. Mais si tu laisses la chance à un amour sain, ça prend plus de temps, mais ça vient.

©Alessia Gunawan
Tu clos l’album par la chanson éponyme « Sad Lovers and Giants ». Quand on pourrait s’attendre à un final en paix, tu n’hésites pas à montrer ta vulnérabilité, et le disque se finit sur une note mélancolique. Quelle est la leçon à retenir ?
Avec un an de plus, j’aurais fait une chanson heureuse (rires). J’ai écrit cette chanson avec le refrain de « We Found Love » de Rihanna en inspiration. Les dernières phrases donnent de l’espoir : même si le toxique a réussi son coup, je me relève. C’est positif au final.
Est-ce que le titre est une référence au groupe post-punk Sad Lovers & Giants ?
C’est une vraie coïncidence, parce que j’ai trouvé le nom de l’album sans penser au groupe que je ne connaissais même pas. Puis Elliot Berthault, avec qui j’ai produit l’album, m’a parlé du groupe, et ça a bien concordé avec l’ambiance de l’album. Pendant la conception du projet j’écoutais des musiques que je n’écoutais pas avant : trip-hop, Cocteau Twins, Jeff Buckley, Massive Attack, shoegaze… Donc Sad Lovers & Giants va avec ce que j’écoutais autour de l’album.
Plus littéralement, qu’elle est la signification derrière ce titre assez poétique ?
‘Sad lovers’ c’est le couple, et ‘Giants’ pour les émotions qui prennent le dessus : l’immensité de la tristesse, de la rage ou de l’amour… Les amoureux tristes se font écraser par les géants.
Tu te retrouves dans la « Princess » de 2020 ?
Oui. Je me retrouve en elle. Je chantais beaucoup avant, puis j’ai perdu ça dans le deuxième EP, et là je l’ai retrouvé. Sur cet album, c’est la petite Crystal Murray qui ne fait que ressentir. Je me suis retrouvée dans la moi qui n’avait qu’une idée en tête : chanter. Cet album n’est que la première étape de ma carrière !