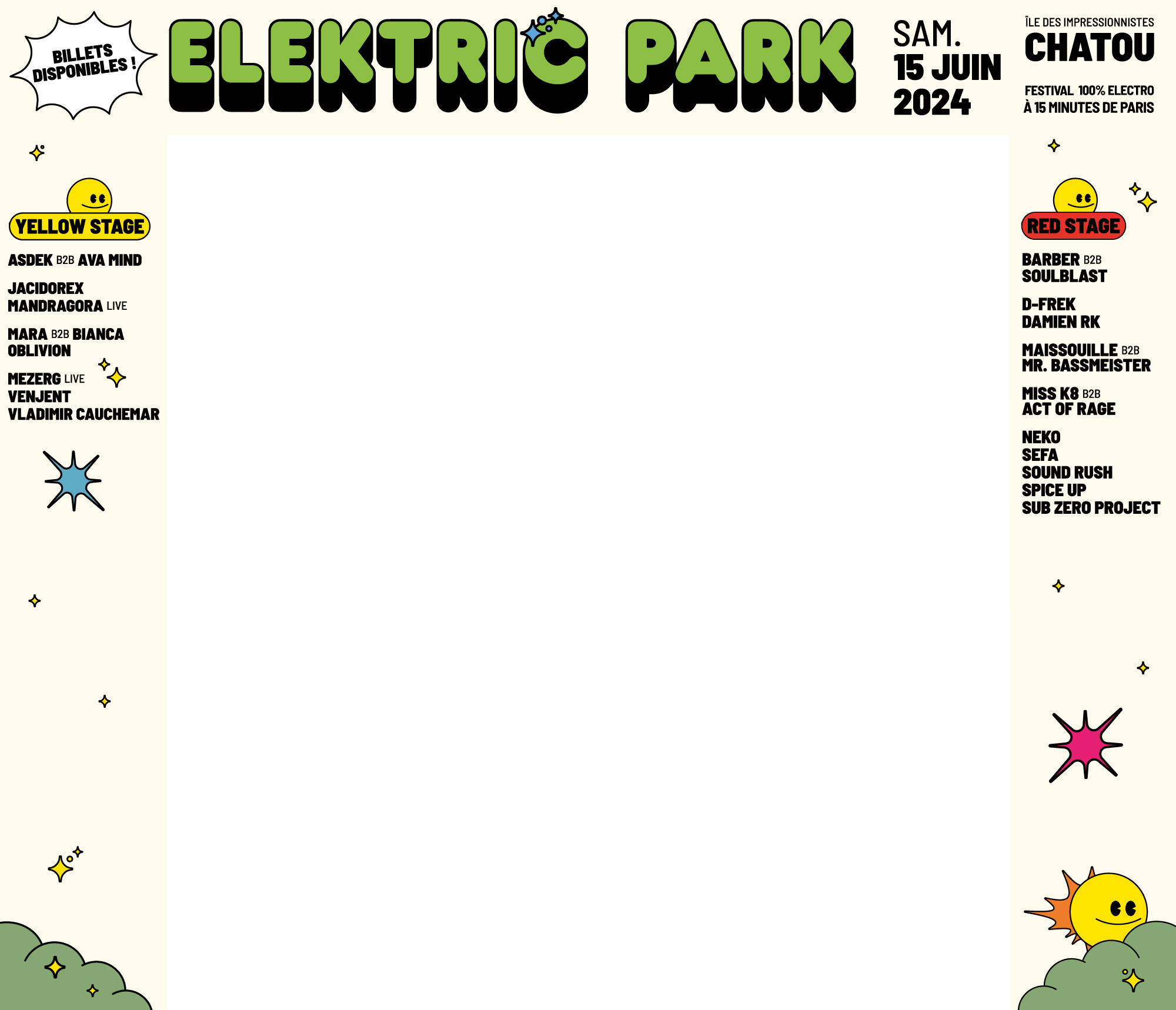« Sous le donjon… », films d’horreur et souvenirs de rave : rencontre avec Manu le Malin
Hier sortait Sous le donjon de Manu le Malin, le docu retraçant la vie d’Emmanuel Dauchez, entre raves, hardcore, festival Astropolis et renaissance. Un film touchant, original, loin des bio classiques, et incroyablement bien filmé. Vous l’aurez compris, on a aimé. On a d’ailleurs tellement aimé qu’on a voulu en discuter, au bureau, avec Manu le Malin. De quoi oublier presque toute la mythologie autour de ce loup solitaire : vapoteuse au bec, Emmanuel se marre, souvent, se moque de lui-même, constamment, et évoque avec plaisir un docu… Qu’il n’a pas toujours voulu. (Long) entretien.
Tu as tout de suite été emballé par le projet de Mario Raulin ?
Mario a réussi à me faire dire « oui » très vite, mais c’est aussi parce que je ne me rendais pas compte de ce que ça impliquait ! Un an après, je lui ai dit non… Mais c’était trop tard, le projet était lancé, le crowdfunding aussi. J’étais piégé ! (rires)
Pourquoi ce changement d’avis ?
J’ai eu des doutes au moment de l’écriture, dans laquelle je me suis pas mal impliqué. L’idée n’était pas de faire un film sur la carrière de Manu Le Malin, parce qu’elle n’est pas énorme non plus – je n’ai pas sorti 25 albums, ou fait de tour du monde, tu ne peux pas faire un documentaire sur moi comme sur des mecs comme Daft Punk, Justice ou Garnier. Mario voulait plutôt prendre l’angle humain, et là j’ai compris qu’il fallait que je me livre… J’ai eu envie de faire marche arrière ! Mais il a su me parler, c’est quelqu’un que j’apprécie et il a vraiment respecté ce que je voulais… Et surtout ce que je ne voulais pas. C’est de là qu’est venue l’idée de faire des scènes de fiction pour illustrer certains passages de ma vie. J’avais en tête 20 000 jours sur Terre de Nick Cave. Il m’a dit que j’étais complètement dingue de prendre un si grand film comme référence mais je préférais viser haut.
Ça n’a pas été trop difficile de te mettre en scène ?
Non, pas vraiment. Pas exemple, la toute première scène de fiction met en image quelque chose de très personnel. Je ne voulais pas raconter ça face caméra, ça n’aurait pas été joli, et de toute façon j’en aurais été incapable. Déjà que ça a été difficile de faire de la voix off ! J’ai dû faire une quinzaine de prises rien que pour ce passage, où j’explique rapidement les conditions dans lesquelles je vivais enfant. Je ne voulais pas faire de psychothérapie de comptoir, et j’espérais que ça ait de la gueule esthétiquement parlant.
Comment s’est passé le tournage de ces scènes ?
On a passé une semaine complète au château avant la soirée Spring pour fignoler et tourner ces fameuses scènes de fiction. J’avais déjà le résultat final en tête, surtout pour ce segment du début, où je parle de films d’horreur, toute ma culture. Notamment L’Exorciste, qu’on évoque dans le docu sans le citer : je l’ai vu beaucoup trop jeune, je n’ai pas dormi pendant quatre-cinq ans, je me suis mis à vivre la nuit et dormir le jour – c’est compliqué pour l’école, d’autant que je vivais seul dans une chambre d’hôtel, livré à moi-même. Ce film m’a beaucoup marqué, et j’ai d’ailleurs samplé L’Exorciste 2 pour faire mon premier (et seul) album, Fighting Spirit, sur plusieurs morceaux comme « Share My Wings » ou « Mental Illness ». Et me faire filmer trois fois pour avoir au montage cette espèce de « détriplement » de la personnalité, ça marche bien aussi avec ce que je suis : on est plusieurs dans ma tête ! (rires)
Est-ce que cette expérience t’a donné envie de te lancer dans la réalisation de film, de docu, de clip peut-être ?
Non pas vraiment, je n’ai ni les moyens ni les relations pour me lancer sérieusement derrière une caméra. On m’a proposé plein de projets de ce type cela dit, notamment pendant ma période de creux, mais j’ai toujours dit non. J’ai de toute façon dit non à beaucoup de choses à cette époque-là.
C’était un creux de la vague subi, mais un peu choisi aussi ?
Oui, complètement. Quand tu n’as plus envie, ce n’est plus la peine ! On en parle un petit peu dans le film, et puis ça s’est vu : ça n’a pas été facile pendant quelques années. Mais tout va bien maintenant !
Dans le film, l’histoire commence vraiment en 1997, avec cette première soirée organisée par Astro au château de Keriolet. Ça t’a marqué ?
Je ne savais pas où j’allais, les gens d’Astro ne me l’avaient pas dit ! Et je suis arrivé dans cet endroit magnifique, et j’ai pris une tarte… J’en prends plein des tartes dans ma vie, et c’était une de plus. Mais je ne suis pas objectif quand je parle d’Astro, ce sont mes potes, c’est comme une seconde famille – un peu comme une première même. En tout cas, ce lieu est magique.

Crédit : Sourdoreille Production
On raconte qu’après tes sets à Keriolet tu aimais t’isoler dans le château, avec les gargouilles. C’est vrai ?
Oui ça m’est arrivé ! On a d’ailleurs voulu le filmer, mais je me suis rendu compte qu’avec le temps j’avais développé un véritable vertige. Je ne peux plus y aller… Alors que ça ne me posait pas trop de problème avant. J’ai déjà grimpé sur un château d’eau à 12 mètres de haut, mais je n’étais pas vraiment dans mon état normal (rires). Je déconseille évidemment de faire ça, ne faites pas ça chez vous, mais je n’avais plus le vertige ! Quoiqu’il en soit j’ai toujours aimé me balader dans ce château, y rester longtemps après la fin du festival. A chaque démontage d’Astro je zonais dans le coin avec mes potes, et dès que c’était un peu dégagé, on ressortait les enceintes, les platines, et on remettait ça jusqu’au lundi matin. Les équipes d’Astro me disaient que je faisais chier… Mais c’était les premiers à aller danser !
Il y a une scène assez intéressante dans le documentaire, où tu racontes que, finalement, tu t’en foutais un peu de la musique dans tes premières raves, car l’important c’était de se retrouver en une petite communauté.
Oui, mes premières, je les ai vécues comme ça.
C’est une opinion qu’on t’a reproché ? Il y a beaucoup de puristes qui ont dû s’en offusquer…
Je trouvais ça génial les raves, mais je m’en foutais de savoir qui était derrière tel ou tel morceau. Après, j’ai bien sûr commencé à m’y intéresser quand je me suis mis à mixer, et notamment aux origines de cette musique – même si vingt après je ne sais pas toujours qui est dans mon bac, comme le dit Gildas dans le docu. De toute façon j’ai toujours été un peu à part, un peu sauvage, et mes débuts de DJs dans les raves n’ont pas forcément été très bien accueillis. Un bon paquet de gens ne m’ont plus du tout parlé de la même façon une fois que j’ai commencé à mixer. Et ces gens-là… Je les emmerde, en gros. J’ai fait ce que j’aimais, ça a changé ma vie, et c’est tout ce qui compte pour moi, plutôt que d’aller cirer des pompes à celui qui a inventé ceci ou cela. Alors ça, forcément, ça n’a pas toujours plu.
Et toi, ce qui t’a plu au tout début, c’est surtout la dimension sociale de ces soirées…
Je viens d’un milieu violent, des rues de Paris, des stades de foot… Ce n’est pas un secret. Si tu veux voir la vie comme un livre, le mien était à peine commencé et les pages n’étaient pas très jolies. Et là, un nouveau chapitre s’ouvrait avec les raves. C’était le bonheur. Je sortais de prison quelques années avant, je ne demandais qu’à m’ouvrir aux gens – je suis un gentil garçon malgré tout ! Je voulais communiquer, et les disques m’ont permis de le faire, sans même que je réalise vraiment que ma passion allait devenir mon métier – et vice et versa. On était 1000, 2000 ou 3000, et il n’y avait pas une histoire, pas un regard de travers, pas un coup de pression… Contrairement à toutes ces choses que je connaissais dans ma vie d’avant, dans laquelle je commençais vraiment à étouffer. Je commençais déjà à sortir dans les clubs, et j’allais là où on faisait le plus la fête sur cette nouvelle musique qui me touchait : dans les boîtes gay, aussi parce qu’il n’y avait pas de bastons. L’extension de ça, ça a été les raves. Je me suis donc sociabilisé, et j’ai vieilli, mon caractère a repris le dessus, mais j’ai gardé ma tribu, ma meute de loups.

Crédit : Sourdoreille Production
Ça a encore du sens cet esprit communautaire quand on vieillit et devient adulte ? On associe souvent l’envie d’avoir une « tribu » à l’adolescence…
Bien sûr, même en vieillissant c’est important de garder ça ! Alors oui, quand maintenant on se réunit entre personnes aimant la fête et cette musique, on est 30000. On n’est plus tous là pour les mêmes raisons… Mais ce n’est pas grave ! Il faut que ça continue parce que, pour faire vraiment de la psychologie de comptoir, c’est important de pouvoir s’échapper du quotidien. Car la vie en 2017 est vachement moins facile qu’en 1990. Et ce n’est peut-être pas un hasard s’il y a une renaissance du courant techno et une scène électronique ultra dynamique en France ces dernières années. Je suis parisien, et il y a des trucs de ouf partout ! Je revis et je ressors ! Au Péripate, Champ Libre, Alter Paname où j’ai joué il n’y a pas longtemps… Pour parler comme un vieux con, ça me rappelle ma jeunesse de raveur ! Je veux continuer à garder cet esprit hédoniste même si je sais que ça ne changera pas le monde, comme je le pensais il y a vingt ans, avec cette musique sans parole et sans frontière. Je m’étais d’ailleurs accroché il y a dix ans avec le journaliste Eric Dahan sur un plateau télé (Fax’O sur M6, en 2007, on a eu beau cherché il n’y a pas de vidéo sur le net, ndlr.) : il disait que pour apprécier la techno il fallait prendre des ecstasys. Bon, aujourd’hui je ne suis pas loin d’être d’accord avec lui (rires). Mais à l’époque on essayait comme on pouvait de défendre l’intérêt artistique de cette musique. Je lui ai répondu que pour moi la techno c’est l’anti-conformisme, l’anti-repli sur soi, et un mélange des peuples – un black de Detroit nommé Jeff Mills envoie sa musique à un blanc de Francfort, Marc Acardipane, et là naît le hardcore ! C’était ça la beauté du truc, et c’est toujours le cas ! Quoique, visiblement l’ouverture d’esprit ne se retrouve plus trop dans certains publics…
Tu parles du gros dérapage sur le mur Facebook de Laurent Garnier ? (Pour rappel, Laurent Garnier a passé « Porcherie » des Béruriers Noirs à la fin d’un set au Rex Club, devant une marée de jeunes doigts d’honneur levés. Quand il a post la vidéo de ce moment sur Facebook, une foule de fans électeurs du FN ont hurlé, ndlr.)
Oui. C’est bien la première fois que je suis allé commenter quelque chose sur Facebook sous le nom de Manu Le Malin, alors que j’ai arrêté d’être revendicatif ou vindicatif il y a longtemps. Au début, je l’étais, je prêchais pour ma paroisse, la musique techno. Mais politiquement ça a toujours été compliqué : je n’ai pas eu le droit de vote pendant plusieurs années suite à mes soucis judiciaires. Mais je me suis pris une claque en 2002, comme tout le monde. Du coup, depuis, je vote, c’est trop important. Pour revenir à Garnier, j’ai ressenti le besoin de le soutenir quand j’ai vu ces commentaires. Déjà parce que c’est Garnier, c’est le patron. Et puis ce n’est pas la première fois qu’il joue ce morceau, et dans les teknivals c’est un titre qu’on a entendu 150 fois ! Il l’a fait au bon moment, j’ai trouvé ça très classe, et le loup est sorti du bois… Enfin non, c’est moi le loup !
C’est quoi cette obsession avec les loups ?
J’adore les loups, ça remonte à l’enfance. Le Loup-garou de Londres m’a beaucoup marqué, j’ai une belle obsession pour les loups et en particulier pour la lycanthropie. J’ai l’impression de vivre un peu comme ça, en loup solitaire, plus ou moins ancien chef de meute qui s’est retiré tout en continuant à regarder ses petits.
Pour un solitaire tu as beaucoup travaillé en duo, avec Torgull d’abord, puis plus récemment Electric Rescue…
Je suis solitaire dans ma vie privée. Mais musicalement, j’ai des garde-fous, comme Torgull ou aujourd’hui Electric Rescue, qui m’empêchent de péter un plomb. Et je fais de jolies choses avec eux. C’est mon essence ces gens-là. J’ai besoin des gens, et en même temps j’ai un rejet des gens… C’est complexe ! (rires) C’est le week-end, en teuf, que je fais ma thérapie. Je me sens bien derrière les platines, je n’ai pas besoin de parler, je fais de la musique et je fais danser les gens. Toute ma vie est là.
Il y a des vidéos souvenirs assez savoureuses avec Torgull dans le docu à l’époque de Palindrome, mais au final très peu d’images d’archive…
C’est un parti pris de Mario que d’utiliser très peu d’images d’archive. Car sinon on tombe dans un format documentaire classique, et nostalgique. Ce n’est pas notre truc. Les seuls images d’archive qu’on utilise vraiment, c’est en effet de l’époque Palindrome – et là on peut remercier Damien Raclot-Dauliac (le réal d’un autre documentaire s’intéressant à la techno, We Had A Dream, nldr.). On n’aurait pas pu parler de Palindrome sans ces images : il faut le voir pour comprendre ce que j’ai vécu et ce qu’on a fait comme conneries. Tout n’a pas été loupé dans ce projet, il y a un morceau que j’aime vraiment beaucoup sur l’album, « Wolfen ». Sauf que ça a clashé. Ça fait quelques années que Torgull et moi on se revoit. Mais on a reparlé du projet pour la première fois face caméra. Philippe est mon meilleur ami, mais cette engueulade à la fin de Palindrome nous a fait beaucoup de mal. C’était bien sûr lié à un soucis sous-jacent : Philou n’en pouvait plus de mes problèmes d’alcool et de dope. Je fracassais tout autour de moi, pas uniquement Palindrome. Dans notre petite meute, on n’était pas habitué à baisser les bras. Or c’est exactement ce que je faisais à l’époque, quand j’ai commencé à avoir des problèmes de jeu par exemple. Philippe m’est rentré dedans, on en est presque venu aux mains, et ça chez nous c’était interdit : dans notre bande, il y avait du respect, on se parlait correctement… Quand je vois les jeunes se dire aujourd’hui « enculé » ou « ta gueule » entre potes, je ne comprends pas trop : on ne se parlait pas comme ça ! Donc le fait qu’on se dispute si fort, ça a cassé un truc. Pendant dix piges, on ne s’est pas adressé la parole, ou alors un texto pour les anniversaires. Mais ça c’est fini, on s’est bien retrouvé !

Manu le Malin et Torgull. Crédit : Sourdoreille Production
A la toute fin du docu, on entend ce morceau, « Misericordia », que vous avez produit pour votre duo W.LV.S.. Il va sortir officiellement un jour ?
On attend. Si ça ne tenait qu’à moi il serait déjà sur le net en téléchargement gratuit. Mais Rescue me retient, me dit qu’on va faire un joli maxi. Ce n’est pas pour faire de l’argent – on en va pas en faire, on le sait ! -, plutôt pour sorti un bel objet. On a deux maxis de prêts, on cherche juste le bon label.
Quant au générique de fin, il a été filmé à la Super 8 c’est ça ?
Oui. C’est Victor, le cameraman, qui a eu cette idée, c’est super joli. On s’était noté tout un tas d’idées dans le genre, j’avais envie qu’il y ait plein de petits clips tout au long du docu. Par exemple, il y a un loup dans le film. Il s’agit d’un hybride qu’on est allé cherché dans une ferme animalière pour le cinéma… Et finalement il ressemblait beaucoup plus à un chien qu’à un loup, donc on a gardé assez peu de plans. Au moins, ça m’a permis de voir des loups de près à la ferme, j’étais content ! On a quand même su se couper de certaines envies – enfin ça surtout été plus dur pour moi, je voulais même finir à poil à la fin avec le loup, pour retourner dans la forêt comme un loup-garou. Tant pis ! (rires) Pour revenir sur la petite histoire du générique, je devais apparaître à l’image. Mais c’était à la fin de la Spring, je venais de jouer cinq heures, j’avais vraiment envie qu’on me laisse tranquille, d’autant que j’avais déjà une semaine de tournage dans les pattes. Du coup, j’étais caché aux pieds de Laurent Garnier, en tailleur, en train de lui faire des cœurs avec les doigts. C’était cool.