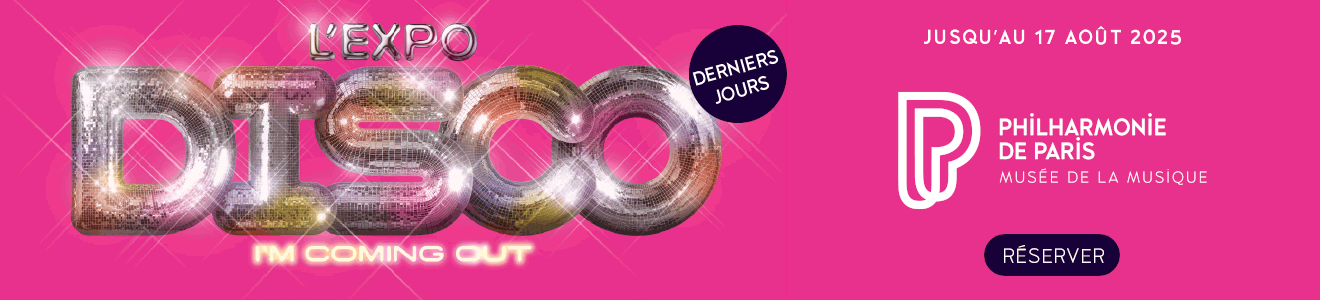En 2008, sur les ruines du Triptyque, rue Montmartre à Paris, le Social Club devient rapidement l’épicentre physique d’une scène jusqu’alors florissante sur MySpace et les blogs. C’est le point de repère d’une génération d’artistes bien décidés à faire de ce petit espace parisien le symbole de leur effervescence créative. Sept ans après sa fermeture, en mai 2016, celles et ceux qui ont contribué à sa renommée se souviennent.
Cet article est issu du Tsugi 165 : Culture Clubs : où va le clubbing ?
Manu Barron: L’idée du Social Club est partie d’une opportunité assez folle. Alors que je passais des vacances pseudo-hippies dans les Cévennes, sur un terrain où un pote stocke des yourtes, un de mes anciens associés m’appelle et me dit qu’il a trouvé un lieu incroyable pour monter un club ensemble. On m’avait déjà proposé ce genre de plan des dizaines de fois, en Belgique ou ailleurs, mais j’avais toujours refusé. Ma culture vient des concerts, des squats, des festivals, pas des boîtes de nuit, qui ont longtemps incarné pour moi un truc assez beauf. Pourtant, j’y ai vu l’opportunité de créer un lieu international en plein Paris.
Micky Faria Da Rosa: Avant de gérer l’accueil artiste au Social, je sortais déjà beaucoup au Triptyque. En 2008, il y avait bien le Rex Club, qui était hégémonique, mais le Pulp venait de fermer et il manquait un club qui parle autant à la nouvelle génération qu’à un public plus adulte.
Para One: Étant donné que j’avais déjà mes habitudes au Triptyque et que je connaissais bien Manu, j’ai pu visiter le Social Club lors des travaux. Du design à sa taille, plutôt petite, de l’ambiance relativement sombre à l’emplacement du DJ-booth, collé au public, l’équipe avait envie de mettre un coup de frais à la scène clubbing.
Manu Barron: Le rachat des dettes du Triptyque s’est fait dans la débrouille la plus totale. On n’avait pas de fonds d’investissement, à peine le soutien d’une banque. Avec mes associés, Arnaud Frisch, Antoine Kraft et Antoine Caton, on a investi notre propre argent. Moi, par exemple, j’ai revendu la baraque que j’avais à Lille pour me lancer dans cette aventure. Quant au nom, il s’est imposé de lui-même: certains craignaient le rapprochement avec les mouvements sociaux, un truc pas très rigolo, mais j’étais persuadé qu’il symbolisait notre volonté d’être un lieu rassembleur. Dans la foulée, j’ai appelé Laurent Fétis et il a créé ce logo qui a été copié 3000 fois depuis.
Laurent Fétis : J’avais rencontré Manu par le biais de Soulwax et Das Pop, dont il s’occupait. À l’époque, je contribuais à un blog avec mes copains de Dirty (Clovis Goux et Guillaume Sorge) et travaillais beaucoup pour des labels comme International Deejay Gigolo et Gooom (M83). Avoir carte blanche pour s’occuper de l’identité d’un tel club était évidemment une opportunité incroyable, même si je ne croyais pas trop au Social au début. La programmation était trop folle pour être vraie…
À lire aussi : Paris : où en est la culture club ?
Micky Faria Da Rosa: Il y a d’abord eu une inauguration privée le mercredi 16 janvier 2008 avec plein de guests (Zongamin, Étienne De Crécy, Das Pop, Gildas&Masaya de Kitsuné), puis trois jours de fête pour célébrer l’ouverture du lieu. Au programme: Felix Da Housecat, Yuksek, Les Putafranges, Busy P, SebastiAn, Scratch Massive, etc. Cette programmation était pourtant trompeuse: au début, le Social était un club plutôt techno, avec des soirées berlinoises ou minimales pilotées par mon collectif, Get The Curse, ou, plus tard, par Dement3d, le label de François X.
Manu Barron: Le Rex avait d’ailleurs peur du Social au début, l’équipe craignait qu’on empiète sur leur créneau en faisant des soirées techno. Nous, tout ce que l’on voulait, c’était participer à une effervescence, créer une dynamique.
Anaïs Carayon (fondatrice de Brain Magazine): Ce n’était peut-être pas la plus grande époque musicale que cette terre ait portée, mais le Social donnait l’impression de vivre une énergie nouvelle. Il y avait une vraie hystérie à chaque soirée.
24 Hour Party People
Manu Barron: Pour les premières soirées, on n’était pas stressés. On savait que le buzz lié à l’ouverture d’un nouveau club allait nous porter pendant quelques mois. D’autant que l’on ne débarquait pas de nulle part, on avait tous un réseau. Après un an et demi, j’ai toutefois compris que l’on avait gagné notre pari: les gens venaient quoiqu’il arrive. Le Social Club participait alors à une ouverture d’esprit, des fans d’électro pouvaient venir à des soirées minimales ou baile funk. On avait réussi à briser les chapelles.
Micky Faria Da Rosa: L’avantage du Social, c’est d’avoir rapidement pu compter sur des labels et des collectifs prêts à s’approprier le lieu. Institubes, Ed Banger, Marble, ClekClekBoom, les gars de Fluokids : toute une génération est née avec ce club.
Manu Barron: Les artistes avaient tellement pris leurs habitudes que le line-up sur scène était souvent moins prestigieux que celui que l’on pouvait retrouver dans le public. Ça a participé à l’effervescence du lieu: les gens étaient là pour danser.
Para One: Le Social était un endroit où l’on avait envie de traîner, parce que sympathique et populaire, pas du tout élitiste ou chiant. Mon avis est peut-être biaisé sachant que j’étais là en tant qu’artiste, mais je venais réellement au Social dans l’idée de retrouver les potes, pas uniquement pour la programmation. Il faut dire qu’il était hyper bien situé, vachement central. À l’époque, tous les chemins menaient au Social.
Don Rimini: Il faut préciser que SavoirFaire a été créé au même moment, que les artistes du label comme Birdy Nam Nam étaient toujours là, et que les studios sous le Social ont servi de lieu d’enregistrement pour Justice ou les gars de Sound Pellegrino.
Sam Tiba: Lorsque je joue pour la première fois au Social Club, le 3 septembre 2009, je suis encore un jeune DJ de Lille, Club Cheval n’est qu’un embryon, mais Manu souhaite me tester en première partie de Major Lazer… Diplo était mon idole et, même s’il ne m’a pas trop calculé ce soir-là, j’ai trouvé au Social une nouvelle maison. Sans ce DJ-set, il n’y aurait sans doute pas eu de Sam Tiba, pas de Club Cheval, et certainement pas toutes ces soirées/rencontres qui ont découlé depuis.
Canblaster : C’est clair que le Social représente une grosse part de notre vie…Ma première fois en tant que DJ, c’était dans le cadre d’une soirée du label Nightshifters. Le headliner de la soirée, DJ Donna Summer, m’avait proposé de prendre 30 des 90 minutes de son DJ-set. Teki Latex était dans la foule et est venu me féliciter alors que l’on ne se connaissait pas encore… Ça en dit long sur ce côté très familial, avec toute une génération d’artistes prêts à squatter les lieux. Notamment les backstages.

Magazine Social Club n°5, 2008
Back dans les bac(kstages)
Manu Barron: Au début, les backstages faisaient 10 m2 , tout au plus, mais ils donnaient directement sur la scène, ce qui permettait aux invités de profiter de l’ambiance et du DJ-set. Par la suite, on a cassé un mur afin de construire un escalier, d’agrandir l’espace et de le rendre plus agréable.
Micky Faria Da Rosa: Ça devait être le coin le plus petit de Paname avec le plus de monde à l’intérieur. Sincèrement, c’était un club caché au sein même du Social, tout le monde se battait pour y squatter. Notre meilleure idée, ça a été de ne pas mettre d’enceintes au sein des backstages : si ça avait été le cas, personne ne serait jamais sorti de cet endroit.
DJ Falcon: Je me souviens notamment de ce mur mansardé où tout le monde s’est forcément cogné… Il faut dire que l’on était tellement dans ces loges, assez chaotiques, mais finalement propres à l’identité du lieu, intimiste sans être trop confidentiel.
Alan Braxe: Je ne veux rien enlever au public, qui était l’élément central du Social, avec cette façon de lever les bras à chaque morceau plutôt que de danser de manière éparpillée, mais je ne peux pas nier la manière dont les backstages ont soudé une scène. Avec mon label, Vulture, on y organisait quatre soirées par an et, à chaque fois, on était là de 23h à 6h du matin, à discuter de ghetto house avec Jean Nipon, à rire avec les gars de Marble, etc. Au Social, il n’y avait pas de loterie: tu étais certain de passer une bonne soirée.
Don Rimini: J’ai perdu beaucoup de points de vie dans les loges, mais c’était un formidable lieu, ultra-libre, où j’ai pu discuter pendant des heures avec des mecs aussi différents que DJ Mehdi ou Arnaud Rebotini.
Micky Faria Da Rosa: J’allais souvent chercher les artistes non parisiens Gare du Nord ou directement à l’aéroport. Forcément, ça participait à créer un esprit de camaraderie, même si ça n’évitait pas les imprévus. Une fois, par exemple, on avait perdu Switch pendant plus de 24h… Il est finalement réapparu une heure avant son set. Il y a aussi l’un des gars d’Octave One qui est tombé dans les escaliers des backstages avant de jouer. En stress, on est alors parti en vitesse récupérer une attelle et tout le nécessaire dans une pharmacie de nuit Porte de Clichy, et les gars ont pu assurer leur show.
Sam Tiba: On se connaissait tous, on produisait tous plus ou moins la même musique, et on évoluait tous dans plusieurs collectifs. Canblaster, par exemple, était à la fois chez Marble, Institubes, Pelican Fly et Bromance, ça créait des connexions et des discussions réellement enrichissantes. En prime, on avait l’opportunité de prolonger nos réflexions dans le magazine du Social: un vrai bel objet!
Avoir bonne presse
Laurent Fétis : Manu et Arnaud avaient envie de créer un magazine dont l’identité visuelle partait de la couverture et se déclinait en affiches, en flyers, etc. L’idée était d’introduire dans cet objet une multitude de références culturelles liées au monde de la musique.
Manu Barron: Ça restait un medium promotionnel censé vendre nos soirées, mais on avait de bonnes intentions artistiques. On avait envie de donner la parole à des artistes qui avaient des choses à dire, de proposer quelque chose de visuellement très fort, mais aussi de lancer des sujets pointus. L’objectif, c’était d’aller au-delà de la culture club, de s’intéresser au cinéma, à la littérature, au graphisme.
Laurent Fétis : Le magazine était une sorte d’ovni où l’on avait la possibilité d’inviter régulièrement des artistes à créer des posters : So Me, Gaspard Augé, Jean-Paul Goude, Pharrell, Takashi Murakami. C’était tellement chic pour un magazine gratuit…
Sam Tiba: En 2012, j’ai eu l’opportunité d’écrire deux articles. Le premier a été réalisé avec Myd, autour de Fatman Scoop. Le second était nettement plus visionnaire et expliquait à quel point la K-Pop allait tout défoncer. En fin de compte, ce magazine est caractéristique de ce qu’était réellement le Social: un lieu d’expérimentation musicale et culturelle, pas du tout un endroit uniquement bon pour pécho des meufs.
Laurent Fétis : Les magazines du Social Club sont, sociologiquement parlant, un témoignage précieux et maladroit d’une époque pas si lointaine. Précieux parce qu’ils m’ont permis d’inviter plein de gens alors à l’avant-garde, tel Daniel Arsham, pas encore connu. Ce qui prouve que l’on fabriquait plus l’air du temps qu’on ne le suivait. Maladroit parce que le magazine était fait sans un sou, avec à peine un peu de pub, et que les deadlines étaient hyper serrées : en quatre jours maximum, tout était bouclé.
‘Je voudrais qu’on laisse entrer le mec venu de Poitiers avec sa meuf dans l’espoir de voir Para One ou Surkin’ (Manu Barron)
Une affaire de famille
Manu Barron: Avoir des objets comme le magazine ou des soirées comme Le Petit Social le mardi, dans une jauge réduite, où l’on pouvait donner leur chance à des jeunes artistes internationaux – Connan Mockasin y a fait son premier concert parisien – illustre bien mon angoisse de la niche. D’ailleurs, je me suis souvent pris la tête pour que les physios ne fassent pas entrer ces mecs qu’il faut soi-disant avoir dans son club pour être bien vu tout en sachant qu’ils n’hésiteront pas à te chier dessus dès qu’un nouveau lieu hype ouvrira. Moi, je voulais qu’on laisse entrer le mec venu de Poitiers avec sa meuf dans l’espoir de voir Para One ou Surkin.
Barbara (social clubbeuse): Une fois, je débarquais de Lille avec des potes pour voir AraabMuzik. C’était la fête, et j’avais bien trop bu. Le videur m’avait recalée et m’avait dit, tranquillement: «Écarte-toi, décuve un peu et reviens après. » J’avais halluciné. Et, effectivement, j’ai pu entrer dans le Social une heure plus tard.
Sam Tiba: C’était un moment béni d’entraide et de découvertes musicales. Lors des résidences Club Cheval, par exemple, on n’avait pas à se prendre la tête sur les budgets. On regardait la liste des artistes que l’équipe souhaitait inviter, on faisait notre sélection et, généralement, on avait qui on voulait. Canblaster : On était dans un délire très UK, et on avait des guests comme Mike Skinner, Mount Kimbie, ou Hudson Mohawke qui était venu jouer masqué un soir d’Halloween. Sam Tiba: On a aussi ramené des concepts. Un soir, chaque membre a donc fait un B2B avec un DJ différent. Myd avec Jef K, Canblaster avec Manu Le Malin, Panteros666 avec David Carretta et moi avec Crabbe. Para One: Pendant trois ans, on a pu y organiser des soirées Marble, où l’on cherchait vraiment à se réapproprier le club. On installait des néons Marble, on se rendait la veille au bar pour définir le goût du «Marble Shot », on vendait du merch, et on s’éclatait à faire venir des artistes que l’on adorait, type DJ Rashad ou Basement Jaxx.
Anaïs Carayon: Avec Brain Magazine, on y a également inventé le concept des Decade, où l’on revisitait plusieurs décennies le temps d’une soirée. Un soir, il y avait par exemple Breakbot pour un set inspiré des années 1970, Marco Dos Santos pour les années 1980, Guido d’Acid Arab pour les années 1990 et Feadz pour les années 2000. On se prenait vraiment la tête, y compris pour faire venir des artistes plus pop, genre Romy et Metronomy, alors qu’une soirée avec Les Petits Pilous ou Crookers aurait suffi à remplir le club.
Manu Barron: Petit à petit, on a aussi cherché à ouvrir le club au rap, ce qui était très rare à l’époque. C’était même l’angoisse des boîtes, mais ça nous semblait important. D’autant que DJ Mehdi et Brodinski y tenaient aussi. Du coup, on y a fait jouer des nouvelles têtes, type A$AP Rocky, et des légendes comme DJ Premier.
Para One: Il y a aussi cette soirée hommage à DJ Mehdi où, avec Brodinski et d’autres, on n’a joué que du vinyle hip-hop des années 1990. Mehdi rêvait de cette soirée, c’était forcément très émouvant.
Canblaster : Un soir, Just Blaze était venu et c’était complètement absurde. Il proposait de l’électro depuis son point de vue américain, pas très en phase avec l’esthétique du club. Ce qui était marrant, c’est qu’il a accompagné son set de toasts comme dans le rap. Au moment de jouer «Warp 1.9» des Bloody Beetroots, il a même coupé le son, a pointé du doigt un gars du public et lui a demandé de se mettre à danser. Il est tellement massif, tout le monde a pris peur. (rires)
Fin de Party
Para One: Dès que je croisais un pote au Japon, à New York ou en Australie, c’était la même chose. On me demandait systématiquement s’il y avait moyen de venir jouer au Social. Au croisement des années 2000-2010, le club avait une renommée internationale, c’était un gage de qualité, un tremplin, porté par une programmation qui a fait un sans-faute pendant au moins cinq ans.
Micky Faria Da Rosa: J’avais 20 ans lorsque j’ai commencé à travailler au Social. J’y étais trois ou quatre fois par semaine, sans jamais vraiment prendre de vacances. Le rythme était intense. Après quatre ans, il était temps de passer à autre chose.
Manu Barron: Je n’avais jamais pensé le Social comme un club qui puisse durer vingt ans, mais ça aurait pu arriver. En tout cas, je n’ai pas du tout eu l’impression d’avoir fait le tour; il y a toujours de nouvelles générations à découvrir. Le truc, c’est que des désaccords de plus en plus profonds ont commencé à naître avec mes associés. La façon de procéder ne me convenait plus, je me détachais de plus en plus de la programmation, il était temps pour moi de me consacrer à SavoirFaire.
Anaïs Carayon: On a fini par s’embrouiller avec Antoine Caton et Arnaud Frisch, qui nous devaient 20000 euros. Pour les récupérer, il a fallu faire appel à un huissier, téléphoner chaque jour, etc. Lors d’un reportage pour Brain, un de nos journalistes avait même découvert que le Silencio, ouvert par la même équipe, devait de l’argent à des centaines d’artistes/collectifs, parfois 400 ou 500 euros. Sans doute que cette idée de club privé les a foutus dans la merde. Peut-être aussi que le départ de Manu Barron a tout précipité.
Canblaster : Avec Para One, Brodinski, Sound Pellegrino ou Surkin, on se demandait également ce que l’on allait bien pouvoir faire après toute cette effervescence pour la turbine et la bloghouse. Le Social nous a alors permis de tester des sons plus R&B, plus rap, moins rock dans l’énergie.
Manu Barron: Hormis les soucis avec mes associés, ce que je préfère retenir du Social, que j’ai fini par quitter en 2014, deux ans avant sa fermeture définitive, c’est ça: un lieu où l’on pouvait voir des gens de toutes générations s’éclater ensemble, un endroit où j’ai découvert énormément de monde. Parfois, avant qu’ils ne deviennent connus, comme Skrillex qui est d’abord venu en tant que client; d’autres fois, avant de travailler avec eux, comme Gesaffelstein, que Brodinski m’avait présenté.
Para One: Avec le temps, j’ai pu croiser un tas d’artistes, et c’est fou de voir à quel point le Social a marqué les esprits. Il y a un héritage, c’est certain. Des gens se souviennent religieusement de certains sets, d’autres, comme le chanteur Hervé, me disent qu’ils étaient au premier rang chaque week-end.
Manu Barron: La vérité, c’est qu’on a créé une génération. La moitié de celles et ceux qui bossent dans l’électro aujourd’hui, en tant qu’artistes, programmateurs ou DA, viennent du Social. Soit parce qu’ils ont grandi avec nous, soit parce qu’ils se sont construits en réaction à ce qu’était le club. En huit ans, le Social a largement contribué à redynamiser une scène française – cette fameuse french touch 2.0 mais pas que. Et c’est clair que l’aventure n’a pas duré aussi longtemps qu’elle aurait pu.