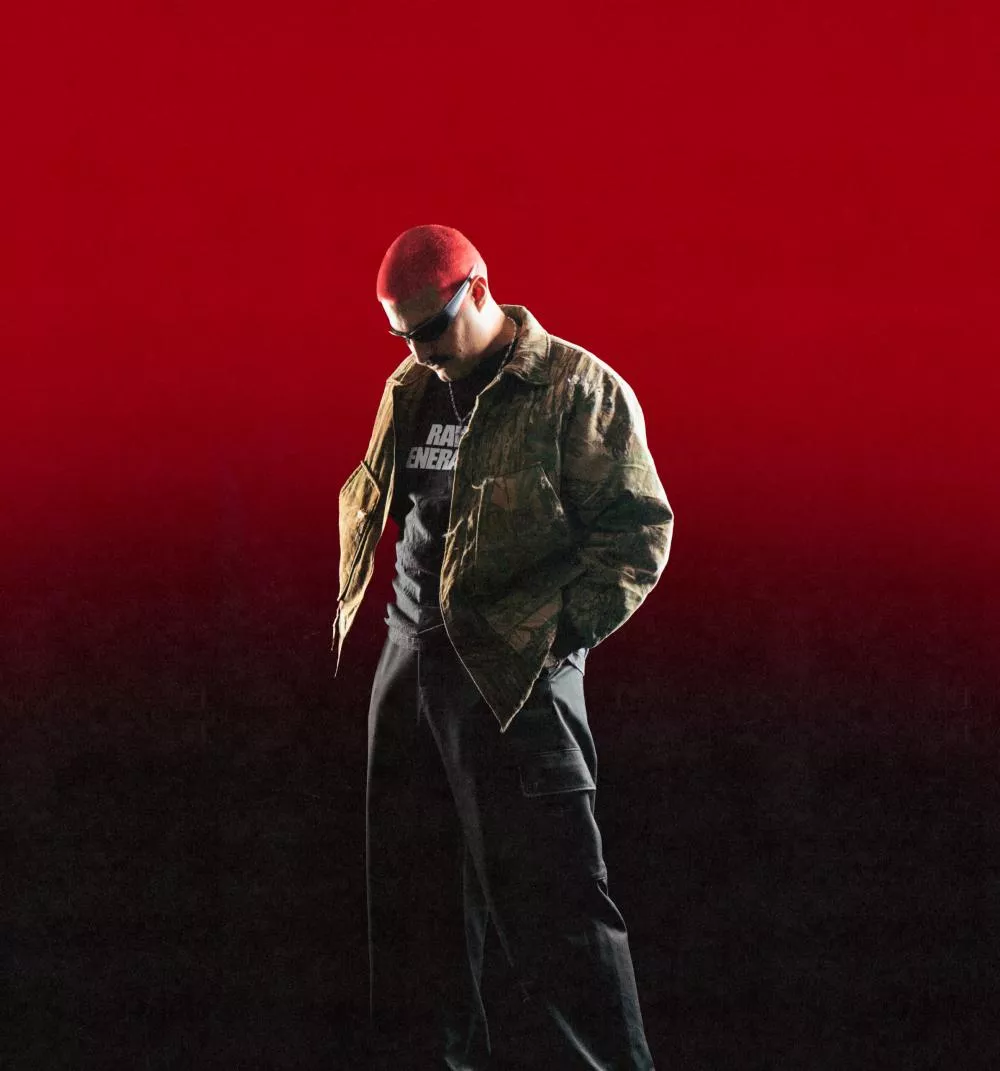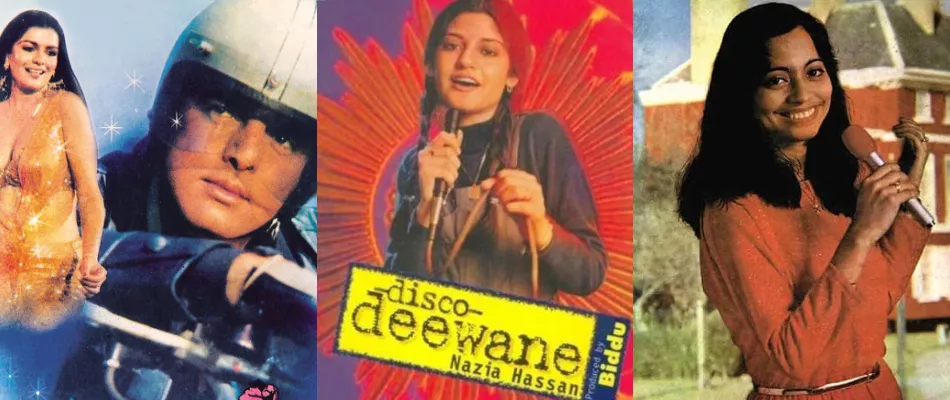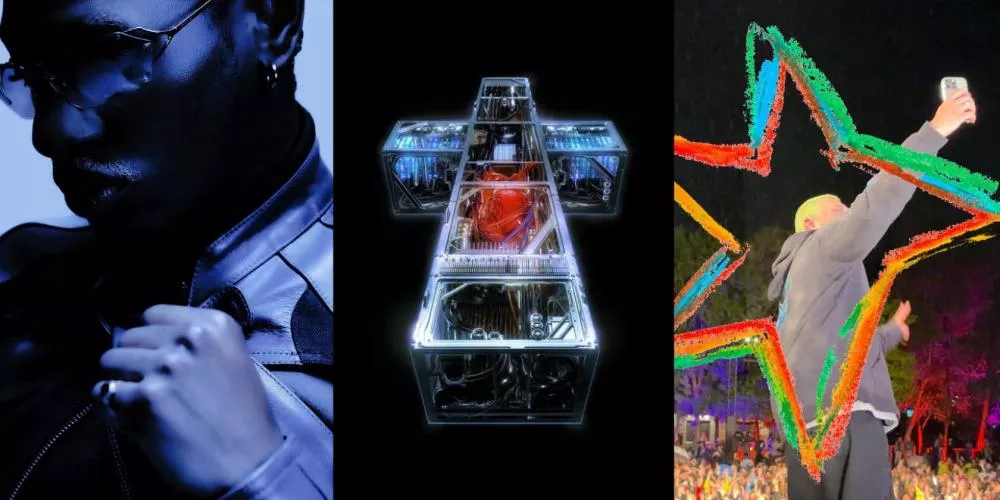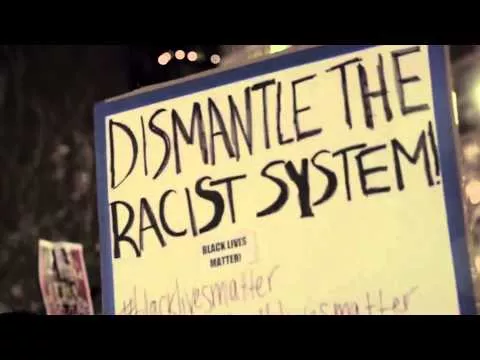En 1993, une jeune Allemande originaire d’une petite ville de province est propulsée manageuse du Wu-Tang Clan, avec pour mission de faire connaître le groupe new-yorkais dans le monde entier. Un défi impossible, du moins en apparence. Retour sur l’un des featurings les plus WTF de l’histoire du hip-hop.
Par Julien Duez
À quoi ça tient une carrière ? Celle d’Eva Ries a commencé par un refus. « Grâce » à un refus pourrait-on même dire. « J’ai toujours aimé peindre. Après mon bac, j’ai donc déposé ma candidature à l’Académie des beaux-arts de Karlsruhe », se souvient cette fille d’instituteurs, originaire de la petite ville de Ladenburg, près de Mannheim, dans le sud-ouest de l’Allemagne. « Mon père imaginait que je deviendrais prof d’arts plastiques. Ça lui convenait bien. Mais mon dossier a été refusé et je ne suis jamais devenue la nouvelle Picasso ! »
Pas défaitiste pour un sou, Eva Ries quitte sa province pour se remettre en selle. Direction Berlin-Ouest – le Mur n’est pas encore tombé. Elle y étudie la photographie et shoote le rockeur allemand Udo Lindenberg, sa « porte d’entrée dans l’industrie musicale » à une époque où « il fallait obligatoirement un diplôme en économie d’entreprise pour espérer faire carrière dans le management ». Celle qui écoute alors AC/DC, Metallica et Def Leppard à fond de balle débute en assurant la promo de Nirvana, Aerosmith et Guns N’ Roses en Allemagne pour le compte de la filiale allemande de Geffen Records, basée à Hambourg.
- À lire aussi sur tsugi.fr : L’archive du jour : le Wu-Tang Clan de 1997 en freestyle de 50 minutes
Mais comme nul n’est prophète en son pays, la jeune femme ambitionne de franchir l’Atlantique et le palier qui va avec : « En Europe, nous n’étions que des exécutants des labels américains et c’était devenu frustrant de ne pas avoir voix au chapitre. » Les États-Unis, qu’elle connaît déjà pour avoir suivi des cours d’anglais à Berkeley pendant quelques mois et s’être fait virer d’un stage chez Enigma Records au bout de cinq jours, lui apparaissent comme « la terre de tous les possibles », loin de cette « Allemagne trop bureaucratique » qui ne semble pas connaître « l’apprentissage sur le tas ».

Une lune de miel qui tourne au vinaigre
Comme dans tous les récits de success-story, le destin viendra lui donner un coup de pouce. En 1993, apprenant qu’un poste se libère au département marketing du label RCA, Eva Ries tente sa chance. Cette fois-ci, sa candidature ne se solde pas par un échec. À 31 ans, la voilà qui s’envole vivre son rêve à New York. À l’époque, la Grosse Pomme était bien moins gentrifiée qu’aujourd’hui. « La drogue et la violence étaient omniprésentes. Et dans les rues autour de mon bureau situé sur Times Square, ça sentait très fort la pisse ! »
On est loin du soleil et de la chaleur de Los Angeles qu’elle affectionne tant, mais qu’importe. Avec cette promotion, la petite provinciale va changer de dimension et gérer des groupes qui la font kiffer. Les ZZ Top par exemple. Du moins, c’est ce qu’elle croyait. « J’ai signé mon contrat les yeux fermés. Naïvement, je pensais que j’allais effectivement m’occuper d’artistes rock, mais quand j’ai dit ça à un collègue, il m’a regardée avec de grands yeux et a répondu : “Ah non ! Ça, c’est mon job ! Toi, tu t’occupes des artistes de chez Loud !” » Première douche froide. Loud Records, la branche hip-hop de RCA, possède un catalogue d’artistes alors cantonnés au territoire des États-Unis.
« Au début des années 1990, des groupes comme Run‐DMC, Public Enemy et N.W.A. avaient, certes, réussi à s’exporter un peu, mais leur style restait malgré tout très underground. Or, ma nouvelle mission, c’était justement de rendre le hip‐hop mainstream à l’international », soupire Eva, pas franchement optimiste au départ. « Je ne m’étais jamais vraiment intéressée au hip‐hop. J’étais enfermée dans ma bulle hard rock, convaincue que ce style n’intéressait que les communautés noires urbaines américaines. Et je n’imaginais pas que l’on puisse trouver un public équivalent en Europe… »
- À lire aussi sur tsugi.fr : L.A. : Public Enemy supplie d’arrêter de poster « Burn Hollwood Burn » pour illustrer les incendies
« Comment est-ce que j’étais censée vendre cette merde ? »
Le temps de phosphorer sur le chantier qui l’attend, la newbie part fêter sa lune de miel à Hawaï avec son mari. Un soir, devant un coucher de soleil sur une plage paradisiaque, elle branche son Walkman pour tester la démo du premier groupe dont elle doit s’occuper : 36 Chambers, par un certain Wu-Tang Clan. Deuxième douche froide : « En écoutant la bande, j’ai fondu en larmes. Comment est‐ce que j’étais censée vendre cette merde ?!, éclate-t-elle de rire aujourd’hui. Parce que ma réussite allait précisément être jugée sur les chiffres de ventes. Et s’ils n’étaient pas bons, j’allais vraiment avoir un problème. Ma carrière dans l’industrie musicale aurait pu s’arrêter là… »
Eva n’est pas au bout de ses peines. Sa première rencontre avec les neuf membres du Clan (qu’elle ne parvient d’ailleurs pas à réunir aisément) est loin d’être chaleureuse. « Ils se méfiaient qu’on leur ait collé une femme blanche pour faire connaître leur musique à l’international », explique celle dont ni les origines ni le parcours n’intéressaient RZA, Ghostface Killah, Ol’ Dirty Bastard et consorts. Pire encore, les membres du Clan, habitués à gober toutes les théories du complot possibles et imaginables, croient même que cette nouvelle venue est une agente secrète envoyée par le FBI pour les espionner de l’intérieur.

Ambiance… Dès lors, c’est peu dire que la mission que Loud lui a assignée leur passe au‐dessus de la tête : « Je crois qu’en premier lieu, ils voulaient vraiment être connus aux États-Unis parce que leur horizon se limitait à leur propre pays. Ils n’avaient pas de passeport, ils n’étaient même jamais sortis de l’État de New York, confie‐t‐elle. Pour eux, l’Europe, l’Australie ou même l’Amérique latine, ça n’existait pas, et d’ailleurs, ça ne les intéressait pas, puisqu’ils voulaient avant tout faire de la musique pour la communauté noire américaine. »
On l’appelle l’ovni
Catapultée dans un monde dont elle ne connaît rien, la manageuse décide de faire preuve de bonne volonté : « C’est vrai que l’on venait de deux planètes complètement différentes. Notre relation s’est donc construite sur l’idée que l’on pouvait s’enrichir mutuellement. » Ce « double mentorat » s’opère de la façon suivante : d’un côté, Eva Ries apprend « à comprendre leur musique et à connaître leur communauté ». De l’autre, les membres du Wu‐Tang s’engagent « à surmonter leur peur de sortir de leur zone de confort » et à la suivre « en Europe pour participer activement à la promotion de leur œuvre ».
En 1994, le groupe au grand complet s’envole donc en tournée sur le Vieux Continent. À travers la Belgique, les Pays‐Bas, la France, la Suisse, l’Allemagne ou le Royaume‐Uni, Eva comprend vite que ses protégés ont un énorme potentiel auprès d’un public qui n’est ni noir ni américain. Mais ce n’est pas gagné pour autant. Bien qu’éloigné de sa terre natale, le Clan continue de cultiver sa paranoïa légendaire : « Je devais goûter les pizzas qui leur étaient apportées en backstage pour qu’ils soient sûrs qu’elles n’avaient pas été empoisonnées, rit‐elle aujourd’hui. Même chose avec l’eau minérale : elle devait être servie dans des bouteilles scellées, sans quoi ils s’imaginaient que le gouvernement aurait pu la trafiquer ! »
Objectif : dominer le monde
Pour ne rien arranger, ils quittent leurs hôtels en laissant des factures de plusieurs milliers de dollars, passant des nuits entières au téléphone avec leurs proches à New York. Et créent scandale sur scandale dans les restaurants où ils dînent, repartant parfois avec quelques bouteilles de champagne. Si l’image de gangsters des membres du Wu‐Tang Clan est bien réelle (et excellente d’un point de vue marketing), en tournée, ils se comportent surtout comme des sales gosses incontrôlables. Malgré tout, Eva Ries s’accroche. Pas question d’abandonner.
- À lire aussi sur tsugi.fr : Tsugi Daily : Les fils des membres du Wu-Tang dévoilent un premier single en mode old-school
Et c’est à l’occasion d’un concert à Londres qu’elle va définitivement gagner leur respect. Alors qu’elle a donné son accord à une équipe de la BBC pour filmer le groupe dans sa loge, le manager historique des lascars, John « Mook » Gibbons, empêche le caméraman de shooter Method Man en train de fumer un pétard. Le lendemain, dans le tour‐bus, Eva pose un ultimatum : « Soit vous voulez faire du fric, soit non. Mais si c’est oui, c’est moi seule qui m’occupe de la promotion et votre manager doit s’en aller. » La suite va vous étonner : le bus s’arrête et Mook en est éjecté au beau milieu de la campagne anglaise.
« S’ils avaient pris son parti et non le mien, j’aurais pu tout arrêter, avoue‐t‐elle avec le recul. Mais je crois qu’ils ont compris que j’étais en mesure de leur faire atteindre l’objectif qu’ils s’étaient eux-mêmes fixé : dominer le monde. » On connaît la suite : Enter The Wu-Tang (36 Chambers) se vend à près de 9 millions d’exemplaires dans le monde. Mission accomplie.
L’autre cinquième Beatles
Au même titre que Brian Epstein peut être considéré comme le cinquième Beatles, Eva Ries est devenue la dixième membre du Wu‐Tang Clan après avoir été adoubée d’un surnom évocateur : « Evil‐E Killerbee » (« Eva d’enfer, l’abeille tueuse »). « J’étais aussi une institutrice, une psy, une interprète et une accompagnatrice au sein du monde des Blancs, qui était alors totalement nouveau pour eux. Avant moi, ils n’en avaient rencontré qu’à travers la police ou l’administration », résume‐t‐elle. La meute domptée, Eva peut enfin passer plus de temps à s’occuper des autres groupes dont elle a la charge chez Loud, à commencer par Mobb Deep et Big Pun.
- À lire aussi sur tsugi.fr : 1984 : quand le rap lance son premier festival
Au tournant du XXIe siècle, elle bascule quelques années chez Sony avant de se mettre définitivement à son compte. Mais sans jamais s’éloigner de la scène hip‐hop ni des membres de son Clan, comme l’a récemment montré un documentaire diffusé à la télévision publique allemande. Une forme de consécration qui sera bientôt complétée par une adaptation romancée de son parcours sur grand écran. Reste à savoir qui jouera le rôle de cette « petite femme blanche de la province allemande » devenue une Killerbee à l’état d’esprit très américain : « Ce qu’il faut retenir de cette expérience, conclut‐elle, c’est que rien n’est impossible. Les personnes les plus incompatibles en apparence peuvent finir par trouver un terrain d’entente, réussir ensemble et même développer une amitié malgré les préjugés. Il faut juste accepter de sortir de sa zone de confort. »